Cet article est le deuxième d’un triptyque où Philippe de Lara analyse la révolution populiste qui sévit outre-Atlantique. Ici, l’auteur explique que la révolution trumpiste a déjà abouti à une quasi-dictature aux États-Unis. Il s’appuie notamment sur le langage de Trump et de son entourage. Pour lui, il s’agit d’une « entreprise de séparation du langage et de la vérité, telle que la question de la vérité ou non ne puisse plus être posée ». La nature totalitaire du mensonge trumpiste est comparable au cauchemar décrit par Orwell dans 1984.
« Le laisser-aller de notre langage favorise l’idiotie de nos pensées. »
George Orwell1
Depuis que Donald Trump a de facto quitté l’Alliance atlantique et trahi l’Ukraine, il ne se passe pas de jour sans qu’une nouvelle déclaration, une nouvelle décision accroissent l’inquiétude mortelle des Ukrainiens et la sidération de leurs alliés européens. Trump a choisi de s’allier avec Poutine et s’acharne contre les démocraties, hier encore les alliés naturels des États-Unis. Ce renversement d’alliance a et aura des conséquences sur l’ordre et la paix du monde qu’il est difficile de prévoir à moyen et à long termes, car le style du personnage Trump et le climat révolutionnaire qui règne à Washington entretiennent à dessein une imprévisibilité majeure. Imprévisibilité accrue par l’attentisme bienveillant de la Russie – et même celui de la Chine, qui proteste contre la menace de droits de douane mais s’abstient de commenter la politique américaine en Asie2 –, ce qui rend encore plus indéchiffrables la finalité et la viabilité de la stratégie américaine.
C’est exactement la même chose dans la politique intérieure des États-Unis : la plupart des observateurs pressentent que le commando MAGA est en train de transformer le régime américain, mais sans pouvoir apprécier vers où et jusqu’où ira cette transformation : sera-t-elle durable ou sans lendemain ? Comment faut-il qualifier le régime que Trump veut instaurer ? Une démocratie illibérale sur le modèle de la Hongrie d’Orbán ? Un véritable fascisme comme le pensent plusieurs auteurs, notamment Timothy Snyder ? Ou quelque chose de plus inquiétant encore ? Dans cette deuxième partie de « Penser l’inimaginable », je m’efforce de dégager un tableau cohérent du régime trumpiste en construction, à partir des indices chaotiques et déroutants qui nous assaillent.
Une dictature américaine
Un an avant son entrée à la Maison-Blanche, le 10 janvier 2024, Donald Trump déclarait sur Fox News : « Je serai dictateur pendant un jour. » Il ajoutait : « Après ça, je ne vais pas être un dictateur, je vais gérer tout ça comme nous l’avons fait [au cours du premier mandat]. » Un an plus tard, le monde, médusé, découvre que ce premier jour est un jour sans fin. Après deux mois d’exercice, Trump continue de gouverner par décrets présidentiels, à la manière d’un autocrate, bien que la majorité des deux Chambres lui soit acquise. Sa haine de Joe Biden et son mépris pour ses prédécesseurs sont toujours aussi virulents. Il se présente comme un sauveur et rappelle en toute occasion que l’élection de 2020 a été « volée ». Les garde-fous prévus par la Constitution des États-Unis sont comme figés devant la frénésie révolutionnaire du président.
Quand il se heurte à l’opposition des tribunaux ou de la loi, il se contente de louvoyer, comme dans le cas de la liquidation de l’USAID ou, tout simplement, d’ignorer que ses décisions sont illégales3. Qui aurait imaginé que la majorité républicaine du Sénat allait confirmer toutes les nominations soumises à son examen, qu’elle ne craindrait pas le déshonneur et le ridicule en approuvant sans broncher, entre autres, les nominations de Tulsi Gabbard à la tête du Renseignement ou de Kash Patel comme directeur du FBI, malgré leurs antécédents accablants4 ? Aux coups d’éclat autoritaires s’ajoutent des rafales de décisions et de nominations plus discrètes qui, malgré leur allure chaotique, dessinent une révolution bien préparée.
Non seulement Trump balaie les règles et les procédures de l’État de droit, mais il s’en vante. Il met en scène un soi-disant « retour » de l’Amérique ( « great again ») moyennant le saccage de ce qui faisait l’Amérique : les checks and balances (contrôle et contrepoids), en particulier l’indépendance du pouvoir judiciaire, la liberté de la presse, une certaine idée de la liberté individuelle, une relative modération de la vie politique grâce au consensus sur les institutions, la confiance dans le « melting pot » (creuset) qui a su transformer des générations d’immigrants du monde entier en Américains fiers de leur patrie. Ce n’est cependant pas la première poussée populiste autoritaire dans l’histoire des États-Unis. Dans un livre paru en 1964 mais d’une actualité troublante, Le Style paranoïaque. Théories du complot et droite radicale en Amérique, l’historien Richard Hofstadter avait montré l’apparition périodique d’un style paranoïaque dans la vie politique américaine5. Selon lui, « la tendance paranoïaque se manifeste dans la confrontation d’intérêts opposés totalement irréconciliables (ou perçus comme tels) et qui par conséquent ne peuvent être pris en charge dans le processus politique normal de la négociation et du compromis ». Le style paranoïaque est la forme que prend en Amérique l’esprit de sécession (voir mon article précédent). Le titre du livre fait référence à la campagne de Barry Goldwater, candidat extrémiste du parti républicain à l’élection présidentielle de 19646. Mais le style paranoïaque a aussi eu des représentants de gauche, comme Huey Long, gouverneur de Louisiane de 1928 à 1932, défenseur des pauvres et précurseur du New Deal, mais aussi quasi-dictateur corrompu, ouvertement lié à la Mafia. Huey Long fut assassiné en 1935 alors qu’il était candidat à la présidence des États-Unis contre Roosevelt7. Le phénomène Trump a donc des précédents dans l’histoire américaine, mais c’est la première fois que le « style paranoïaque » accède à la Maison-Blanche.
Bien entendu, je n’ignore pas le poids décisif de l’emprise russe sur le nouveau président et son équipe. Donald Trump est assurément le trophée de la guerre cognitive menée par le Kremlin et on constate un peu plus chaque jour que tout se passe comme si Trump était téléguidé par la Russie, comme Françoise Thom l’a montré dans ces colonnes. Les mesures les plus révélatrices de complicité avec le régime de Poutine sont bien sûr l’abandon de l’Ukraine, l’hostilité envers son président – un « dictateur sans élection » à la tête d’un régime « néo-nazi » –, et les déclarations réitérées d’amitié et de confiance envers Poutine – un homme de parole et qui veut la paix (Trump), et « a good guy » (Witkoff). Mais d’autres actes plus discrets sont tout aussi accablants : la purge de l’état-major, l’arrêt du programme de cyberguerre de la CIA visant la Russie et, last but not least, le lancement du projet pharaonique d’avion du futur F47 qui va aspirer une part importante du budget du Pentagone, déjà sabré par Elon Musk, au détriment de la capacité militaire des États-Unis dans les mois et les années qui viennent. Néanmoins, il importe de mettre au jour les sources proprement américaines de la révolution MAGA pour parvenir à une vision complète du phénomène trumpiste.
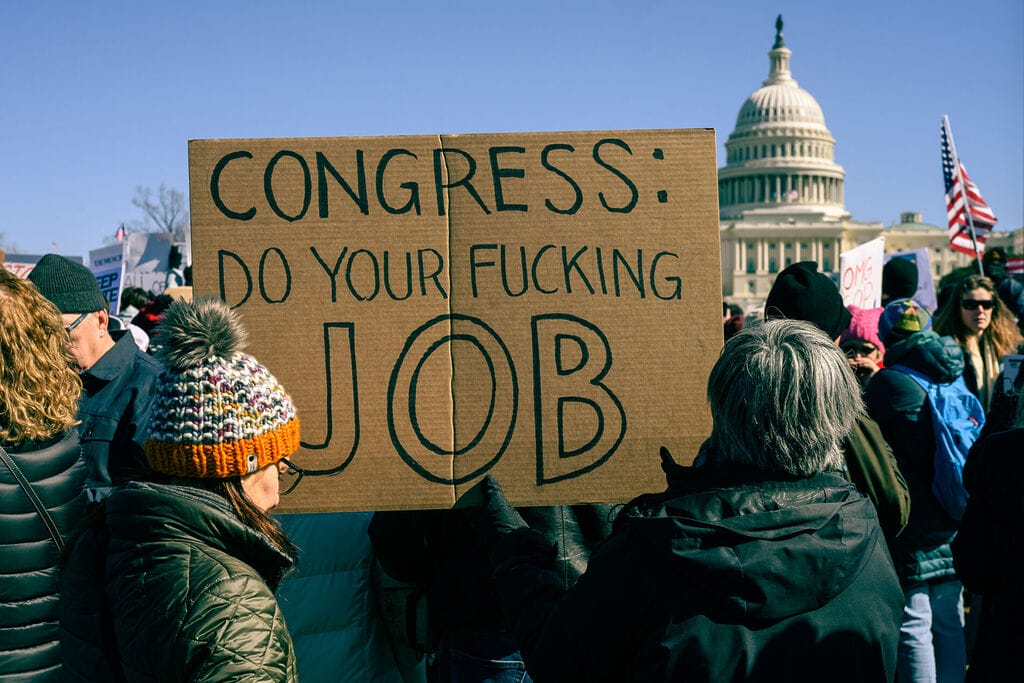
Ce que révèle le langage de Trump
Trump est un personnage à multiples facettes, dont chacune semble brouiller les autres : le tyran, le clown grotesque, le boutiquier, le chef mafieux, l’agent russe, le ploutocrate, le menteur professionnel, etc. L’énormité de ses mensonges et la vulgarité obscène du personnage laissent perplexe. Déjà au cours de son premier mandat, on ne savait qu’en penser. Après sa défaite à l’élection de 2020, il paraissait impossible qu’il survive politiquement à l’équipée lamentable de ses partisans à l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Déroutés par le style du personnage, nombre d’observateurs laissent ce style de côté pour s’intéresser à ses décisions et tenter de leur trouver des explications rationnelles. On évoque ainsi à l’envi la stratégie « transactionnelle » du président ou les « intérêts » des États-Unis, ce qui permet de passer par-dessus ses outrances. Or le style de Trump – sa vanité, ses mensonges, sa brutalité, son inconstance, sa langue débraillée et confuse – est une clé de la révolution MAGA. En voici les traits principaux :
1) La révision du passé
Le cas le plus spectaculaire est son insistance à affirmer que l’élection de 2020 a été « volée », en dépit du fait que ce scrutin a été sans doute le plus vérifié de l’histoire des États-Unis et qu’aucun recours n’a abouti, malgré l’armée d’avocats mobilisée par le camp Trump. Cette légende est devenue l’un des ciments du peuple MAGA : croire au complot pour voler l’élection, c’est croire à tous les autres, c’est manifester sa foi dans le sauveur de l’Amérique. Au cours de la campagne de 2024, Trump avait affirmé qu’il ne reconnaîtrait pas le résultat en cas de victoire de Kamala Harris, ce qui était une menace implicite d’insurrection. Il a continué à brandir cette menace jusqu’au bout, alors même que sa victoire avait fini par apparaître certaine. Il y revient encore aujourd’hui : les agents du FBI et de la CIA menacés de licenciement par le DOGE peuvent sauver leur poste à condition de faire allégeance à la thèse du vol de l’élection.
C’est devenu une banalité, mais il faut souligner le soutien, enthousiaste ou résigné, des électeurs républicains et du Grand Old Party à l’imposition de faits alternatifs de cette sorte. Dans le cas présent, ce n’est ni la vanité de Trump – il ne supporte pas d’avoir perdu, même s’il a gagné ensuite –, ni sa rancune envers Joe Biden, qui sont en cause. La légende de l’élection volée est ce que je propose d’appeler le mensonge-cadre : il accrédite toutes les révisions du passé et autres mensonges en cours. Le « vol » de l’élection de 2020, comme l’épisode de l’attentat manqué contre le candidat, est un signe du caractère providentiel de la victoire de 2024. La Providence divine fait de Trump un sauveur, l’agent d’une rupture historique, qui renvoie dans les ténèbres toutes les administrations précédentes, au moins depuis George W. Bush. La stature de Trump en président qui évite toutes les guerres est non seulement naïve mais mensongère : elle fait comme si les guerres du XXIe siècle n’étaient que le résultat des erreurs de ses prédécesseurs, comme si elles ne résultaient pas de circonstances et d’actions que même le président des États-Unis ne peut contrôler8 (selon Trump, Bush, Obama, Biden, et bien sûr Zelensky sont à l’origine de cette guerre, par leur inaction, ou par leur action). Le discours sur Trump le faiseur de paix est antérieur à l’invasion de l’Ukraine, mais il se loge sans difficulté dans le narratif russe. À nouveau, il le fait toutefois dans un style très particulier : Poutine justifie son « opération spéciale » par un vaste discours historique, qui démontre que la Russie n’a fait que réagir à une « agression » de l’Ukraine et de l’OTAN, elle-même le dernier épisode de l’affrontement séculaire de l’Occident corrompu avec la Sainte Russie9. Trump en revanche soutient la même position au moyen d’un discours confus et incohérent, dans lequel l’invasion de 2022 est tantôt une sorte de catastrophe naturelle qu’il faut arrêter sans qu’il soit question de son auteur, tantôt la faute de Zelensky.
2) La séparation du langage et de la vérité
Les mensonges de Trump ne se ramènent pas aux seuls faits alternatifs, par définition ponctuels. Ces derniers sont accrédités par un langage inouï qui permet d’évacuer les notions même d’agent et de responsabilité, au moyen d’une syntaxe flottante et d’énoncés creux, répétés sans cesse : « Cette guerre n’aurait jamais dû éclater », « des jeunes hommes meurent et il faut arrêter ça », etc. Exemple de ce que j’appelle syntaxe flottante, cette déclaration de Trump sur les termes du cessez-le-feu, qui devraient porter notamment sur « le partage de certains avoirs en Ukraine » : partage entre qui et qui ? L’Ukraine et la Russie, ou les États-Unis ? L’Ukraine disparaît comme partie prenante de ce « partage » et n’en est plus que le terrain passif – « en Ukraine » au lieu de « de l’Ukraine ». Ces imprécisions, ces bafouillements permettent de faire passer ses revirements constants entre l’attitude du négociateur impartial et celle de l’allié zélé de la Russie, et de ne pas relever les humiliations successives infligées par les Russes, chaque fois qu’ils refusent sèchement une suggestion américaine, à commencer par l’idée même de cessez-le-feu – Poutine y oppose l’exigence préalable d’un règlement global des problèmes de sécurité en Europe. Dans cette langue de caoutchouc, il n’y a ni agressé ni agresseur, ni succès ni échec de la « négociation ». Elle est faite pour servir Poutine mais aussi pour plonger sciemment la réalité dans un brouillard où elle s’évanouit.
Le langage de Trump n’est donc pas tant une avalanche de mensonges – il lui arrive même de prononcer des phrases vraies –, qu’une entreprise de séparation du langage et de la vérité, telle que la question de la vérité ou non ne puisse plus être posée. Par exemple, qu’il ne soit plus possible d’évoquer la menace russe. La radicalité du procédé est camouflée par une apparence du cafouillage10 et la répétition d’éléments de langage d’allure anodine, qui soit euphémisent, soit inversent la réalité. L’idée de la méthode « transactionnelle » n’est pas le moindre de ces euphémismes. Trump a réussi à la faire adopter par tous les journalistes, or ce n’est rien d’autre que le remplacement du droit international et du respect des traités par la doctrine poutinienne des arrangements entre les grandes puissances (les seuls États véritablement souverains selon lui).
Comme chez les pro-russes français, Poutine n’apparaît jamais comme un acteur, volontaire et responsable de ses actes, mais comme un être passif, une victime qui ne fait que réagir à ce qu’on lui fait. Mais Trump fait mieux : il crée un monde dans lequel il n’y a plus d’agent auquel on puisse rapporter une action, plus de lien entre une décision et la responsabilité des conséquences, un monde dans lequel il ne peut plus être question des crimes de guerre perpétrés par la Russie, pas même pour réfuter leur existence11. Les « faits alternatifs » qui faisaient sourire se sont transformés en une réalité alternative, au sens d’une réalité imaginaire qui efface et remplace la réalité réelle.
3) La vulgarité de Trump : naturelle ET stratégique
Chaque fois qu’une thèse complotiste est proclamée officiellement, c’est un pas de plus dans la servitude et l’avilissement pour ceux qui y croient. Qu’il s’agisse de la nocivité des vaccins ou des menaces qui pèseraient sur la souveraineté de la Russie. C’est vrai également pour les manifestations de vulgarité dont Trump n’est pas avare : transformation des jardins de la Maison-Blanche en stand publicitaire pour Tesla, présence ostentatoire dans un spectacle de catch, déclarations et tweets dans un langage débraillé. Les discours devant le Congrès sont toujours pour les présidents un exercice d’éloquence distinguée, nourri d’histoire et de référence littéraire. Trump s’est affranchi de cette tradition et s’est exprimé comme d’habitude, mais on ne l’a guère relevé, tant nous sommes déjà habitués à la vulgarité du personnage. On dit qu’il n’accorde de valeur qu’au succès et à l’enrichissement. Il n’a de cesse de transformer le dossier ukrainien en occasion de bonnes affaires. Je me demande si, depuis qu’il a été réélu, son tempérament naturel n’est pas devenu aussi une stratégie délibérée : jouer le gros bébé irascible et autocentré. Elle lui sert à maintenir le flou sur ses positions sans qu’on puisse lui en faire grief ( « il est comme ça ! ») et à imposer la vulgarité comme norme de la vie publique.
Conclusion : un totalitarisme orwellien
On dit que Donald Trump a une capacité d’attention limitée à quelques minutes. Derrière ce travers inquiétant chez un dirigeant mais somme toute amusant, j’aperçois un virtuose du doublepense12 décrit par Orwell dans 1984 :
« Doublepense désigne la capacité d’avoir dans l’esprit en même temps deux convictions antithétiques et de les accepter l’une et l’autre. » (IIe partie, ch. 9)
« Savoir et ne pas savoir, être parfaitement convaincu de sa parfaite sincérité au moment où l’on profère des mensonges soigneusement élaborés, affirmer simultanément deux points de vue qui s’annulent, tout en les sachant contradictoires et sans cesser de croire à l’un et à l’autre […]. Là était la subtilité suprême : induire l’inconscience en toute conscience, puis redevenir inconscient du sommeil hypnotique qu’on vient de déclencher. » (I, 3)
« La duplicité de l’intelligence que le parti exige de ses membres, et qui s’atteint plus aisément dans un climat de guerre, est maintenant presque universelle, mais plus on s’élève dans la hiérarchie, plus elle est marquée. » (II, 9)
Le doublepense s’exerce en particulier dans la modification continuelle du passé :
« Jour après jour, et presque d’une minute à la suivante, le passé était actualisé. Ainsi toutes les prédictions faites par le Parti se révélaient exactes : les documents le prouvaient. […] il ne s’agissait même pas de falsification, simplement de substitution d’une absurdité à une autre. La plus grande partie des données qu’on traitait n’avait aucune sorte de lien avec le monde réel, pas même le lien qu’implique un mensonge patent. » (I, 4)
Sous le régime infernal imaginé par Orwell, le Parti proclamait : « Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. » (I, 3)
Le doublepense n’est pas le produit d’un conditionnement mais une activité, mise en œuvre en permanence : O’Brien, le dirigeant du parti qui manipule puis arrête et torture le personnage central du roman, Winston, prétend qu’il s’agit d’un « petit exercice » mais, en réalité, le doublepense exige un travail mental d’une difficulté comparable à celle d’un contorsionniste pour le corps.
Trump est un virtuose du doublepense car il est capable de mentir et d’oublier aussitôt qu’il a menti avec une facilité confondante.
Le rapprochement du trumpisme avec le monde de 1984 est déjà venu à l’esprit et sous la plume de beaucoup d’analystes : « orwellien ». Malgré tout, je n’écris ce mot que d’une main tremblante. En effet, le régime de Trump pas plus que celui de Poutine ne sont des tyrannies parfaites, comparables à celle du « Parti » dans 1984 : non seulement ils n’atteignent pas le même niveau de contrôle des esprits – sur ce terrain, Poutine est plus avancé que Trump –, mais, et c’est le point le plus important, ils n’ont pas encore atteint la pureté d’un pouvoir qui n’a aucune finalité, qui ne vise que sa propre perpétuation – Trump est en avance sur Poutine sur ce terrain. Chez Trump et Poutine, il existe un reste de désirs humains, qui aspirent à autre chose qu’au pouvoir pour le pouvoir absolu et impersonnel du Parti. Ils veulent l’argent et la gloire (entrer dans l’histoire), alors qu’O’Brien et les siens ne sont que des prêtres dévoués à la perpétuation immobile du Parti.
Un point commun de plus, le régime imaginé par Orwell est stable et susceptible de durer éternellement, car il existe à l’identique dans les trois empires qui se sont formés après une période de révolutions et couvrent toute la Terre, Oceania (dont fait partie la “Zone Aérienne n°1”, anciennement Angleterre, où se déroule le roman), l’Eurasie et l’Asie de l’Est. Ils ont des idéologies différentes (Socang — socialsime anglais —, néobolchévisme, et culture de la négation de soi), mais celles-ci n’ont aucune importance, vu la nature du pouvoir. Les trois régimes sont en guerre entre eux, mais c’est une guerre en trompe-l’œil. Elle sert à mobiliser les populations mais elle ne peut être gagnée. Les trois empires sont alliés à deux contre un, mais changent d’alliance très souvent pour varier le spectacle. La guerre perpétuelle assure la stabilité des trois régimes.
L’Amérique de Trump n’est pas Oceania, ni la Russie de Poutine l’Eurasie, mais leurs dirigeants sont orwelliens à beaucoup d’égards, et donc capables si on les laisse faire de créer un monde orwellien. À l’école d’Orwell, mon argument n’est ni une utopie ni une prédiction, c’est un avertissement.
Maître de conférences à l’université Paris II Panthéon-Assas. Enseigne la philosophie et la science politique. Collaborateur régulier de Commentaire, chroniqueur au magazine Ukrainski Tyzhden. Ses travaux portent sur l’histoire du totalitarisme et les sorties du totalitarisme. A notamment publié: Naissances du totalitarisme (Paris, Cerf, 2011), Exercices d’humanité. Entretiens avec Vincent Descombes (Paris, Pocket Agora, 2020).
Notes
- « Politique et langage », dans Orwell, Œuvres, Pléiade, 2020, p. 1307.
- Trump fait mine de poursuivre la politique du « pivot asiatique » de ses prédécesseurs pour faire pièce à la Chine, mais il menace Taïwan sous des prétextes absurdes. Tout se passe comme si Trump cherchait à constituer un condominium des trois puissances impériales, hypothèse plus probable que celle d’une alliance avec la Russie pour la détacher de la Chine. En effet, le pouvoir de Trump est loin d’être assez installé dans la durée pour espérer briser « l’amitié éternelle » entre la Russie et la Chine.
- À la suite de l’injonction d’un tribunal, il est revenu sur la suppression de l’USAID, mais il l’empêche de fonctionner. La prise de contrôle et les purges des agences fédérales sont illégales, car ces agences sont indépendantes et leur budget est voté par le Congrès.
- Tulsi Gabbard a rencontré Bachar el-Assad et mis en doute les crimes de guerre de son régime, en particulier l’utilisation d’armes chimiques contre des populations civiles ; elle est un relais zélé de la propagande du Kremlin depuis l’invasion de l’Ukraine. Quant à Kash Patel, Trump comptait sur lui en 2017 comme « bourreau politique pour éradiquer et virer » tous ceux à la Maison-Blanche qu’il soupçonnait de ne pas être suffisamment loyaux. Il soutient publiquement la secte complotiste QAnon et pourfend en toute occasion « l’État profond », y compris l’agence (le FBI) qu’il dirige désormais.
- Traduction française parue en 2012, Le Style paranoïaque. Théories du complot et droite radicale en Amérique, Bourin éditeur, Paris, avec une préface remarquable de Philippe Raynaud.
- Goldwater proclamait que « l’extrémisme dans la défense de la liberté n’est pas un vice ». Il s’opposait à la loi sur les droits civiques de 1964 (qui instaurait la déségrégation raciale) au nom de la liberté des États du Sud, et réclamait, notamment, la suppression de la sécurité sociale, la désaffiliation de l’ONU et l’utilisation de l’arme nucléaire contre l’URSS. Sa campagne fut un échec (il n’obtint que 15 % des votes) mais influencera durablement le parti républicain.
- L’épopée de Huey Long est aujourd’hui méconnue, en dépit de sa postérité artistique : la carrière de Huey Long a inspiré un roman (Les Fous du roi, de Robert Penn Warren, Prix Pulitzer 1947) et plusieurs films (notamment de Robert Rossen, de Sydney Lumet et de Raoul Walsh) ; l’un des neveux de Donald Duck fut baptisé Huey en 1937 – je ne sais pas si c’est Riri, Fifi, ou Loulou dans la version française.
- Avec ce raisonnement, on pourrait plaider que Trump est responsable de l’épidémie de la Covid-19, puisqu’elle a éclaté sous sa présidence !
- Discours concocté sous la double égide de la tradition slavophile et du mythe soviétique de la Grande Guerre patriotique.
- Par exemple, je pense que les variations du montant de l’aide fournie par les États-Unis que l’Ukraine devrait rembourser (entre 350 et 500 milliards $) ne sont pas fortuites, elles constituent le brouillard du mensonge.
- Les négociateurs américains ont bien évoqué le rapatriement des enfants ukrainiens déportés et russifiés de force, mais ils parlent d’un accord des parties, comme l’Ukraine avait sa part de responsabilité dans cette situation.
- En anglais « doublethink ». L’ancienne traduction rendait le terme par « double-pensée », la nouvelle, procurée par Philippe Jaworski chez Gallimard est plus exacte et expressive.