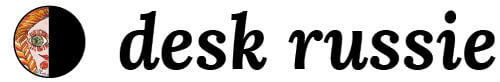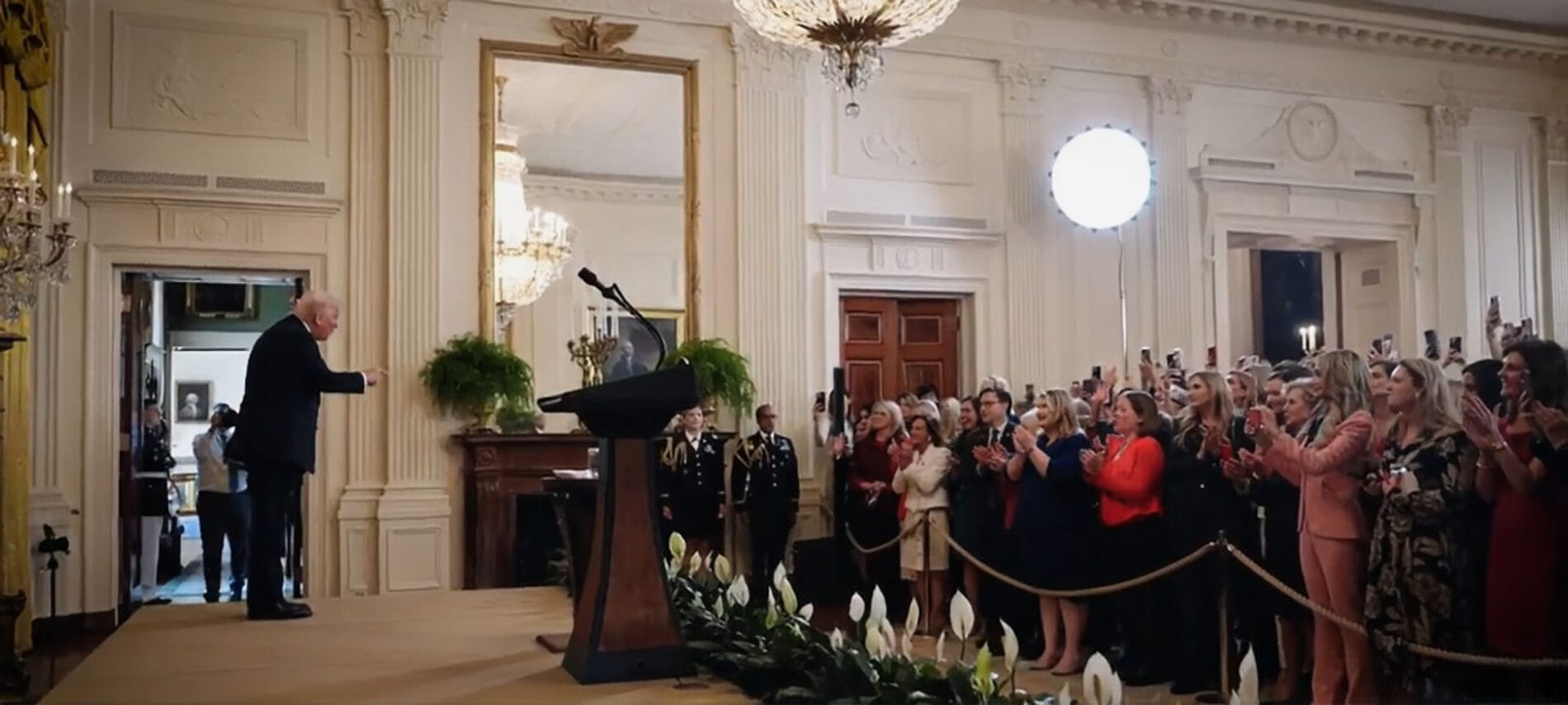
L’auteur montre que la guerre commerciale de Trump participe dans ses effets, sinon dans son intention, à la guerre contre l’ordre international menée par Poutine et ses amis dictateurs, et augmente le chaos mondial, alors que la sécurité de l’Europe est en jeu.
Depuis que Donald Trump a lancé sa guerre des « tariffs » (droits de douane, le plus beau mot de la langue anglaise selon le président américain), une autre guerre, une vraie, la guerre d’Ukraine, a disparu des médias. Le temps de cerveau disponible des populations est accaparé par la guerre commerciale de Trump – d’abord contre le monde entier puis, aux dernières nouvelles, contre la Chine. Pour un peu, nous ne saurions pas que l’Ukraine occupe à nouveau un morceau de territoire russe, cette fois dans la région de Belgorod, une information pourtant importante. Même LCI, la chaîne de télévision qui consacrait le plus de temps d’antenne à l’Ukraine, suit désormais à plein temps le feuilleton des tariffs. Exit l’Ukraine. Cette amnésie soudaine est passablement irrationnelle et même, j’ose le mot, imbécile.
Évidemment, elle est funeste pour les Ukrainiens. L’attention des dirigeants et des opinions publiques passant à autre chose, les décisions militaires et financières des alliés, vitales pour l’Ukraine après le lâchage américain, risquent de tarder encore plus. La protection du ciel ukrainien, attendue depuis le premier jour de la guerre, attendra encore – où sont les missiles Patriot, les avions de chasse européens, indispensables pour empêcher la guerre sauvage de Poutine contre les villes ukrainiennes ? Comme dit le proverbe, « loin des yeux, loin du cœur ».
Mais il y a plus. Hypnotisés par les nouvelles manœuvres de Trump, nous oublions l’échec de la précédente, le cessez-le-feu en Ukraine. Pour y parvenir, Trump était prêt à toutes les concessions en faveur de la Russie dont – disons-le – le sacrifice de l’Ukraine et, d’abord, de son président, coupable d’avoir provoqué le conflit, de rechigner à rembourser le montant de l’aide américaine, et de ne pas porter de cravate dans le Bureau ovale. Trump et ses acolytes ne cachent pas leur mépris, voire leur haine vis-à-vis de l’Ukraine. Le général Kellogg, qu’on disait mieux disposé envers Kyïv, parle maintenant d’une partition de l’Ukraine, sur le modèle de Berlin après la Seconde Guerre mondiale1. Mais la Russie ne marche pas, elle refuse le cessez-le-feu, et exige en préalable à l’arrêt des combats que tous les problèmes de l’architecture de sécurité en Europe (sic) soient résolus aux conditions russes. En changeant de sujet, Trump s’exonère à bon compte de sa trahison, de sa mesquinerie et, pour finir, de son échec sur le « dossier » ukrainien – commentaire cynique d’un ambassadeur français, préposé depuis trois ans aux prédictions défaitistes, « Trump a décidé de lâcher l’Ukraine et il cherche le moyen de le faire de manière élégante » (sic), entendons : en détournant l’attention du monde. Et ça fonctionne : le monde n’a plus d’yeux que pour les tariffs. Et de discourir sur la cohérence ou l’absurdité de la politique américaine, sur la question de savoir si les tariffs sont un bluff du roi du deal ou une entreprise méthodique de destruction du libre-échange et de ses institutions de régulation. Jusqu’au prochain zapping : et maintenant chers téléspectateurs, voici l’invasion du Groenland et l’achat du canal de Panama (ou l’inverse).

Non que la guerre des tariffs soit un sujet négligeable. Les risques de krach boursier, voire de krach bancaire sont bien réels, et la réaction de la Chine ne s’arrêtera pas à la hausse des droits de douanes sur les importations en provenance des États-Unis, notamment parce qu’elle devra trouver de nouveaux débouchés à ses excédents gigantesques, qui vont déferler sur le marché européen. C’est donc bien une promesse de chaos économique et géopolitique. C’est justement là que l’inconséquence médiatique est à son comble : on ne voit pas que les dangers de la guerre des tariffs ne sont si grands et inquiétants qu’à cause de la guerre mondialisée lancée par le Kremlin en février 20222. Sans l’invasion de l’Ukraine, sans les menaces de guerre en Europe, la guerre des tariffs serait une péripétie, grave sans doute, mais guère plus préoccupante que les mesures protectionnistes prises par Trump au cours de son premier mandat. C’est la guerre de Poutine contre l’Occident global qui rend les tariffs trumpiens si dangereux. La sécurité économique de l’Europe n’est un enjeu crucial que parce que sa sécurité tout court est menacée par la Russie. Autrement dit, la guerre russe contre l’Ukraine est l’éléphant dans la pièce, que personne ne voit ni ne veut voir, bien qu’il soit la cause du chaos mondial.
En réalité, la guerre commerciale de Trump participe dans ses effets, sinon dans son intention, à la guerre contre l’ordre international menée par Poutine et ses amis dictateurs. Ce n’est pas être un libre-échangiste béat que de rappeler que, dès l’origine, la fondation d’un ordre international fondé sur le droit, c’est-à-dire sur le principe de l’égale souveraineté de tous les États, allait de pair avec la promotion du commerce international et de l’abaissement des barrières douanières. Le FMI est créé en 1945, suivi par le GATT3, préfiguration de l’OMC, qui sera fondée en 1995. La mondialisation dominée par le dollar n’est pas sans défaut, elle a entraîné des déséquilibres sociaux et écologiques majeurs, elle doit être corrigée et sans doute ralentie, mais c’est un système qui a profité jusqu’à présent à la plus grande partie de l’humanité. Si elle était remplacée par la loi des empires, c’est-à-dire la loi du plus fort, ce serait un désastre pour le monde entier, aussi bien les bénéficiaires que les victimes de l’ordre international libéral.
Maître de conférences à l’université Paris II Panthéon-Assas. Enseigne la philosophie et la science politique. Collaborateur régulier de Commentaire, chroniqueur au magazine Ukrainski Tyzhden. Ses travaux portent sur l’histoire du totalitarisme et les sorties du totalitarisme. A notamment publié: Naissances du totalitarisme (Paris, Cerf, 2011), Exercices d’humanité. Entretiens avec Vincent Descombes (Paris, Pocket Agora, 2020).
Notes
- « Vous pourriez presque faire ressembler cela à ce qui s’est passé avec Berlin après la deuxième guerre mondiale, quand vous aviez une zone russe, une zone française, une zone britannique, une zone américaine », explique le général Kellogg au Times de Londres. Il ajoute que l’Ukraine aurait sa zone au milieu du pays le long de la rive gauche du Dniepr, séparée de la zone russe à l’est par une zone démilitarisée de 30 km de large.
- N’oublions pas que Poutine ne s’est pas contenté d’envahir l’Ukraine. Il aide la Corée du nord à renforcer son arsenal nucléaire, il a donné le feu vert au Hamas pour l’attaque du 7 octobre 2023, il est allié à l’Iran.
- General Agreement on Tariffs and Trade (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). Le GATT était un dispositif de négociation permanente (ou rounds) d’accords multilatéraux de libre-échange. Mis en place entre les 23 pays occidentaux les plus riches, il fut élargi progressivement à un nombre croissant de produits et de pays (117 en 1994, au moment où l’OMC succède au GATT).