Le nouveau livre de Nicolas Tenzer Fin de la politique des grandes puissances. Petits et moyens États à la conquête du monde paraîtra le 23 avril 2025 aux Éditions de l’Observatoire. Avec leur aimable autorisation, nous vous proposons ici de lire en avant-première un extrait de sa conclusion. Cet ouvrage comporte des chapitres spécifiques sur l’évolution de la politique américaine et de la Chine ainsi que des chapitres sur l’Afrique, les pays d’Asie et du Moyen-Orient. Il contient de nombreux développements sur le devenir de l’Europe et le rôle spécifique de la France et du Royaume-Uni. Un chapitre y est consacré à l’Ukraine, modèle de la nation du futur. Il tend à dessiner la perspective d’un nouvel ordre plus libre et sûr et offre une feuille de route aux nations libres. C’est, montre-t-il, la victoire de l’Ukraine qui en constituera la clé.
L’appréhension de la réalité [des guerres] et des failles des principales puissances libres suppose de comprendre quel type d’ordre peut le mieux préserver les nations et les peuples en lutte pour leur liberté des tendances prédatrices des États voyous. Il n’est certes pas suffisant de penser à un schéma ; il faut se donner les moyens de l’organiser. Les « modèles » proposés ne tombent pas du ciel, mais sont du ressort de la volonté des États.
Les schémas classiques habituellement évoqués, non sans simplification, pour décrire l’ordre international, parfois aussi pour le défendre, étaient les suivants. Le premier, appelé ordre bipolaire, était celui de la guerre froide : opposant les États-Unis et l’URSS ainsi que leurs alliés respectifs, il était parfois faussement décrit comme stable. Il était non seulement potentiellement dangereux – c’est pendant cette période-là que le risque nucléaire était le plus élevé – et aussi meurtrier – guerre entre les Corées, guerre du Vietnam, guerres locales entre des États ou des groupes soutenus par l’une et l’autre puissance. Il était aussi une prison pour les peuples de l’ex-URSS, de la Chine et des pays communistes. Il laissait aussi subsister, comme par contre-feu, des dictatures d’extrême droite et des juntes militaires sur quatre continents. La nostalgie qui anime encore certains politiques ou experts est pour le moins mal placée.
Certains estiment qu’après la chute du Mur est apparu un ordre unipolaire dominé par les États-Unis et, plus accessoirement, ses alliés. Or, cet ordre n’était en loin pacifique ni pacifié : la guerre en ex-Yougoslavie était comme la répétition à certains égards de la guerre russe contre l’Ukraine ; le génocide des Tutsis par les Hutus témoignait du silence et de l’inaction devant un crime de masse ; la Chine, avant Xi Jinping, était loin d’être une puissance de paix ; dans les années 1990, la Russie, avant Poutine, préparait sa revanche et commettait des génocides en Géorgie et en Tchétchénie. On oublie aussi souvent la tentative de Gorbatchev en janvier 1991 de reprendre par la force le contrôle sur les pays Baltes et de mettre fin à leur indépendance, qui fit quatorze morts en Lituanie. L’unipolarité était un faux-semblant.
Par la suite, d’autres se sont plu à décrire le monde comme multipolaire, sans qu’on sache quels étaient toujours ces pôles inégaux, vraisemblablement les États-Unis, la Chine, l’Europe, la Russie, l’Inde, avec sans doute des pôles africain, moyen-oriental et latino-américain. Est apparue à ce moment-là, dans les années 2000, l’idée d’une co-organisation du monde et d’un règlement concerté des différends, avec notamment le G20, institutionnalisé en 1999 et dont la première réunion des chefs d’État et de gouvernement eut lieu en novembre 2008. Or, le G20 ne joua aucun rôle sur le plan politique en raison d’oppositions frontales, au mieux à certains moments dans le domaine financier. Surtout, la notion même d’ordre multipolaire est une forme de désordre institutionnalisé favorisé par des puissances révisionnistes qui entendent remettre en cause avec radicalité ses lois existantes. Les tenants de cet ordre, essentiellement ces puissances, visent à accroître leurs dominations sur les pays censément parties de leur pôle, rétablissant ainsi des zones d’influence prohibées par le droit international, et au-delà. La multipolarité s’oppose frontalement à la souveraineté des peuples. Pour les petits et moyens États incapables de se défendre, c’est une manière de tracer la voie vers la servitude.
Il a été loisible à beaucoup de parler de monde apolaire, autrement dit sans régisseur, comme pour symboliser un monde plus anarchique où aucune puissance n’était capable de faire, durablement, régner sa loi ou sa conception de l’ordre. Cela correspond à ce que l’analyste des risques politiques Ian Bremmer avait popularisé sous l’appellation de G-zéro1. Cette désorganisation du monde est marquée par des États-Unis en retrait, une Russie faible, mais capable de poursuivre à la fois ses actions criminelles ou agressives et de recourir à des actions d’influence et de perversion des démocraties, une Chine ouvertement révisionniste et conquérante et une série de puissances régionales, des moyens États du Moyen-Orient à l’Inde, jouant un rôle désordonné de disruption et de potentielle anarchie.
Dans ce monde, la plupart des petits et moyens États sont comme livrés à eux-mêmes, sans appui ferme et considéré comme durable, tentant tant bien que mal à ne pas perdre leur autonomie et finissant parfois par chercher un protecteur à l’égard duquel ils n’ont aucune illusion – et qui peut les asservir. C’est le cas de certains gouvernements africains, d’Asie ou d’Amérique latine enclins à céder aux sirènes trompeuses de la Chine ou de la Russie, parce que la pression est trop forte, la corruption séduisante et l’abstention des autres aveuglante. Voilà où nous en sommes.
Un autre type d’ordre est possible que je qualifierai de G-infini, par opposition au G-zéro. Dans ce monde, les puissances additionnées des petites et moyennes nations, soucieuses à la fois de rééquilibrer le monde sur le plan économique et commercial, et d’affirmer en commun leur force pour contrer à la fois le recul relatif des États-Unis, devenus depuis la seconde présidence Trump une puissance destructrice de la règle internationale, et l’irruption de nouveaux acteurs menaçants, pourraient s’organiser pour agir sur le cours des choses. Ce G serait infini par ses opportunités nouvelles et les modalités d’organisation.
Cet univers serait surtout ouvert, alors que les plus grandes puissances révisionnistes, avec désormais le concours de Washington, entendent fermer le jeu. Il ne serait pas, au contraire, organisé en pôles régionaux ou en alliances prédéterminées où dominerait une puissance particulière, l’entraînant dans des opérations aventureuses contraires à leurs intérêts. Un tel ordre serait aussi fondé sur une extension du droit international autant sur le plan humanitaire et sécuritaire qu’en termes d’échanges. On quitterait là le domaine de la great powers politics. Plus encore, il s’agit aujourd’hui de lui opposer une force de résistance.
Ce monde serait souple en raison des décisions décentralisées des États, des accords qu’ils noueraient entre eux et de leur capacité à s’émanciper, en même temps qu’il serait rigide dans la défense des principes et la mise en œuvre de la loi. Dans un monde dominé par les grandes puissances, les jeux deviennent plus compliqués : certains vont se ranger derrière la Chine ou la Russie parce que leur histoire nationale les empêche de s’allier trop visiblement avec Washington, ou parce que les intérêts économiques de l’Amérique, accompagnés d’un manque de solidarité dans les crises, sont trop antagonistes des leurs. Une voie autonome est particulièrement difficile et il n’est pas fortuit que, depuis leur création, les non-alignés ou ce qu’ils sont devenus ont, de fait, plutôt servi les positions des nations révisionnistes. Quant aux pays européens, ils paraissaient trop liés aux États-Unis ou eux-mêmes anciennes puissances coloniales, et surtout ils n’avaient pas réussi à faire valoir la voie propre qu’ils avaient pourtant définie tout en l’assortissant pour l’instant des moyens de la puissance.
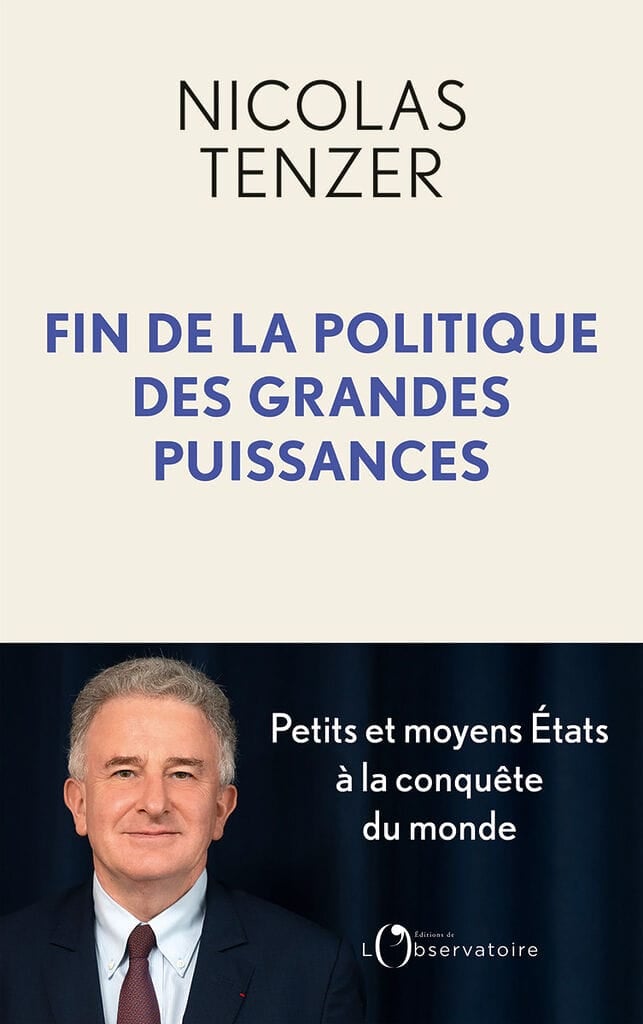
Avec Washington passée du côté des puissances révisionnistes, il sera plus aisé aux États tentés de ne pas s’opposer à Moscou et Pékin par défiance de l’Amérique de définir une voie autonome. L’Europe, désormais, pourrait incarner cette voie vers un monde mieux réglé par le droit et où les trois supposées grandes puissances n’auraient plus le dernier mot. Les moyennes nations seront également perçues comme des terres plus sûres pour les investisseurs et d’autant plus attractives, notamment l’Europe, qu’elles se seront enfin mises en ordre de bataille pour devenir des géants de l’innovation. L’économie de guerre qui devra être la leur représentera un formidable facteur de richesse et de développement technologique comme le furent les États-Unis à partir des années 1960. Là aussi, le modèle ukrainien apparaîtra comme un modèle à portée mondiale.
Le tableau que j’ai décrit ici est certes contrasté. Il y a loin de la coupe aux lèvres ! Les petites et moyennes puissances ne sont pas encore, loin de là, parties à la conquête du monde, même si elles en sont l’avenir. Pour autant, certains mouvements commencent à poindre en cette direction, en Ukraine d’abord, en Syrie depuis la chute du clan Assad, au Bélarus, en Géorgie, en Moldavie, dans certains pays du monde musulman, de l’Iran à l’Algérie, mais aussi de l’Afrique et de l’Asie où les peuples continuent à poursuivre leur combat pour une politique plus digne.
Une conscience commence à se faire jour, y compris chez des dirigeants non démocratiques, d’Asie centrale et du continent africain, que, devant le manque d’engagement de Washington, puis sa trahison, ils sont laissés largement à eux-mêmes pour contrer les entreprises de domination des puissances révisionnistes.
Les États européens, de leur côté, voient non seulement qu’ils devront assurer par eux-mêmes leur sécurité, mais aussi qu’ils devront s’engager plus, sur d’autres continents, pour éviter que ces phénomènes de prédation des richesses et d’influence politique ne minent par ricochet leur propre sécurité. Ils savent ainsi que, pour ce faire, ils devront acquérir les moyens de la puissance et s’unir pour développer avec une masse critique suffisante les investissements scientifiques et technologiques du futur2. La compétitivité future du continent européen ne saurait toutefois être conçue indépendamment d’un projet européen de politique internationale. La guerre qui vient les y conduit.
Cet ouvrage n’entendait pas établir de prévisions sur la manière dont, dans les décennies à venir, le monde allait se remodeler.
Un scénario noir n’est pas à exclure. Dans celui-ci, la Russie ne sort pas complètement vaincue ; des pays, y compris occidentaux, et d’abord les États-Unis, désormais dévoyés, se précipitent à nouveau vers Moscou pour nouer des accords, reprendre les échanges commerciaux et la sauver de l’écroulement. Celle-ci garderait non seulement son pouvoir de nuisance, mais également d’attraction précisément car les démocraties occidentales continueraient d’apparaître veules, lâches et incohérentes, y compris pour leur propre sécurité. Pékin considérerait cette situation comme du pain bénit qui la conforterait dans l’idée qu’une stratégie révisionniste peut être payante. Renforcée, elle continuerait ses entreprises de préhension des richesses sur tous les continents et, conséquemment, de domination politique, accélérant la dépendance de l’Occident, pouvant conduire celui-ci à un dénuement en matériaux et produits stratégiques et à des crises économiques et sociales majeures. Les États-Unis, certes toujours puissants et de plus en plus autosuffisants, se sentiraient suffisamment, quoique sans doute illusoirement, en sécurité pour ne plus se soucier du reste du monde. Pire encore, ils se lanceraient, à côté de Moscou et de Pékin, à des attaques majeures contre les principes de l’ordre international définis à San Francisco et à Nuremberg. Au-delà même des enjeux économiques et directement sécuritaires, la liberté reculerait dans le monde et en Europe même.
Mais il est aussi un autre scénario : celui d’une résistance du monde. Unies, les puissances démocratiques peuvent l’emporter et même convaincre les États aujourd’hui autoritaires qui gardent malgré tout une certaine idée de l’indépendance de leur nation – somme toute, tant la Turquie que les États moyens d’Asie centrale et plusieurs pays africains la partagent. D’autres, y compris dans le Golfe, en Asie et en Amérique latine, malgré l’incohérence de leur politique étrangère, comprennent que leur intérêt n’est pas la soumission. Ils pourraient renoncer à leur politique de gribouille qui laisse pénétrer la Chine ou la Russie sur leur propre terrain. Les pays démocratiques eux-mêmes conservent encore une prééminence économique et certainement militaire. Les BRICS+ sont loin d’être un clan uni, comme leur dernier sommet l’a montré, et il est loin d’être assuré que leur future monnaie voie le jour et a fortiori, si tel devait être le cas, qu’elle soit dominante. Certes, la liberté recule dans le monde de manière inquiétante, mais il est de puissantes forces contraires. Il est aussi probable que la Russie soit finalement vaincue et que même un Trump, aussi complice soit-il avec Moscou, ne soit pas capable de permettre sa survie et de lui restituer un statut de grand qu’elle a définitivement perdu. La Russie pourrait entraîner les États-Unis dans sa chute.
Avec l’Europe, dont on ne saurait mésestimer le devoir historique, mais sans ni domination ni précellence, peut donc finir par s’instaurer cette alliance de containment que j’évoquais entre des petites et moyennes nations qui voudront définir un avenir libre. Le signal offert par une victoire de l’Ukraine sera assurément déterminant, à la fois symboliquement et en pratique. Elle devrait faire des émules. Beaucoup ne perçoivent pas encore les changements que cela impliquerait bien au-delà de l’Europe : elle serait un encouragement pour l’Asie centrale, le Moyen-Orient et l’Afrique, car elle montrerait qu’une soi-disant grande puissance peut être vaincue par la seule force d’un peuple en armes. Les mouvements en chaîne qu’elle déclenchera seront d’une ampleur que peu imaginent aujourd’hui. Le succès de la Révolution syrienne montre que les anciennes dominations ne sont pas établies éternellement. Alors que, dans le monde ancien, il était habituel de considérer que les grandes puissances formaient un axe de sécurité – quand bien même il annonçait la guerre –, la sécurité et la liberté de demain adviendront à travers les petits et moyens États.
Non-resident senior fellow au Center for European Policy Analysis (CEPA) et blogger sur Tenzer Strategics. Analyste des questions internationales et de sécurité, ancien chef de service au Commissariat général du Plan, enseignant à Sciences-Po Paris, auteur de trois rapports officiels au gouvernement et de 23 ouvrages, notamment Quand la France disparaît du monde (Grasset, 2008), Le Monde à l'horizon 2030. La règle et le désordre (Perrin, 2011), avec R. Jahanbegloo, Resisting Despair in Confrontational Times (Har-Anand, 2019) et Notre Guerre. Le crime et l'oubli : pour une pensée stratégique (Ed. de l'Observatoire, 2024).