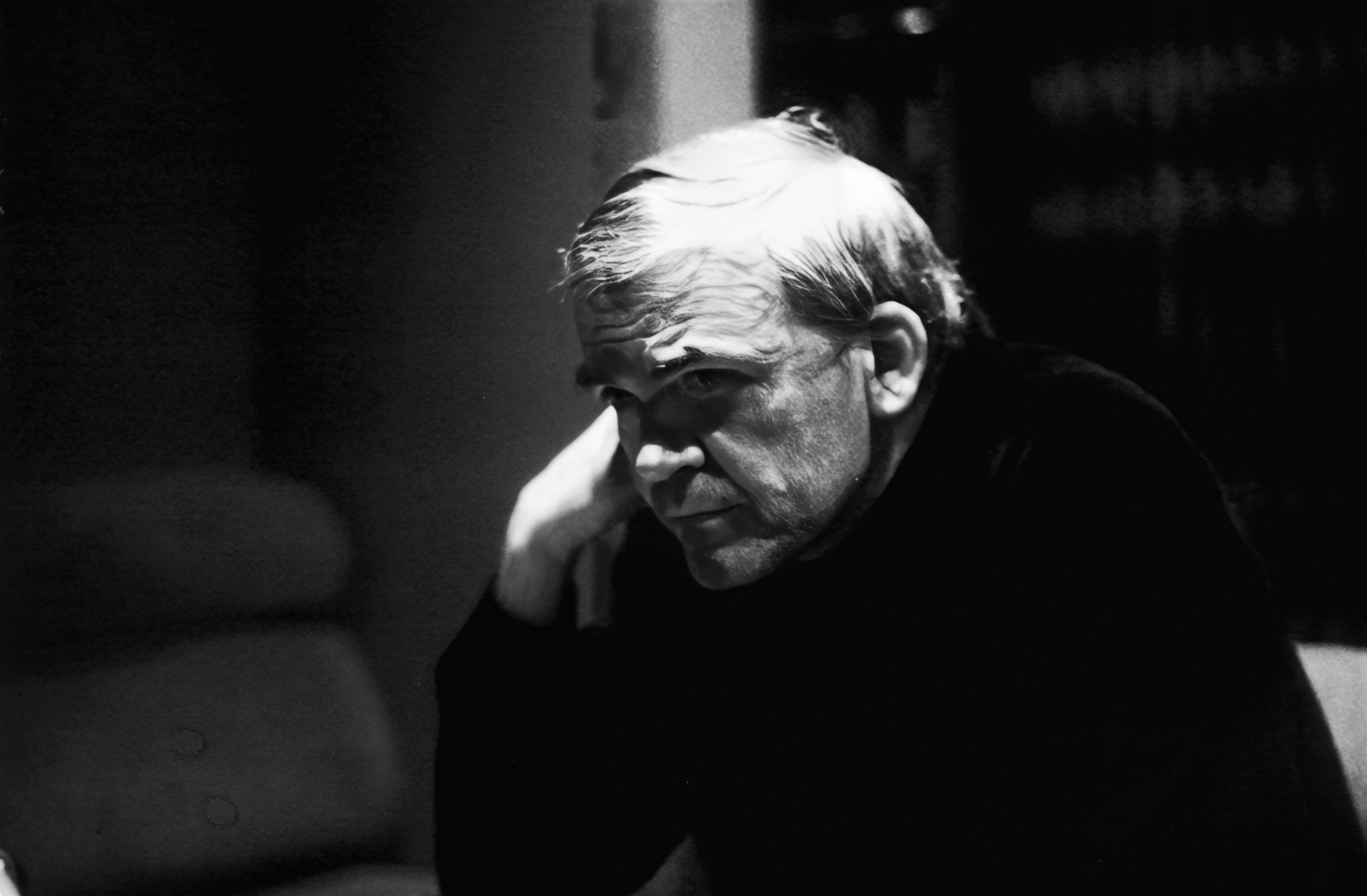Le débat sur l’attitude à tenir face à la culture russe depuis l’invasion de l’Ukraine se poursuit vivement sur les réseaux sociaux. La polémique qui avait opposé en 1985 Joseph Brodsky à Milan Kundera fait l’objet de nombreux commentaires et prises de position. Desk Russie a choisi de publier la réflexion de l’essayiste ukrainien et éditeur Anton Pugach.
Milan Kundera nous a récemment quittés. En lui rendant hommage, les Ukrainiens, plus que d’autres, se rappellent la polémique qui a éclaté entre lui et Joseph Brodsky en 1985. Il faut d’abord revenir à la thèse de Kundera : dans son article, il faisait allusion à l’existence d’un lien intrinsèque entre les chars soviétiques qui ont envahi la Tchécoslovaquie en 1968 et Dostoïevski. Kundera établit ce rapprochement non pas au regard des opinions réactionnaires du grand écrivain russe, mais plus profondément en relation avec son esthétique où règne l’hégémonie du sentiment.
L’hypothèse de Kundera était paradoxale et audacieuse pour son époque, alors qu’il se gardait d’approfondir sa réflexion sur le sujet. En effet, l’essai de Kundera commençait par cette allégation au sujet de Dostoïevski et de l’armée soviétique, mais les trois quarts du texte étaient consacrés à d’autres questions. Néanmoins, même ce bref propos introductif fut perçu par l’un des émigrés soviétiques les plus en vue de l’époque, Joseph Brodsky, comme une attaque contre Dostoïevski. Dans les pages de The New York Times Book Review, le poète russe publia une réponse polémique et acerbe : « Pourquoi Milan Kundera se trompe au sujet de Dostoïevski ».
Aujourd’hui, en 2023, la polémique alimentée par ces deux textes, de Brodsky et de Kundera, résonne avec plus d’actualité qu’à l’époque de leur parution.
L’essai de Kundera précède sa pièce Jacques et son maître1, qu’il intitule également « Hommage à Denis Diderot ». L’écrivain franco-tchèque prend Dostoïevski comme point de référence. Pour Kundera, ce classique russe est le meilleur exemple de ce qu’il rejette, en tant qu’Européen moderne, comme son plus grand contraire. D’où vient l’aversion de l’auteur vis-à-vis de « cette écrasante irrationalité rationnelle » ? Il expose d’abord ses motivations, en racontant un épisode qui lui est arrivé à Prague, le troisième jour après l’invasion soviétique de 1968. « À un moment donné, ils ont arrêté ma voiture. Trois soldats ont commencé à la fouiller. Une fois l’opération terminée, l’officier qui l’avait ordonnée m’a demandé en russe : “Как Вы себя чувствуете?”, c’est-à-dire : “Comment allez-vous ?” Sa question n’avait rien de malicieux ou d’ironique. Au contraire. C’est un gros malentendu, poursuivait-il, mais ça va s’arranger. Vous devez comprendre que nous aimons les Tchèques. Nous vous aimons ! »2
Cette description correspond presque exactement à ce qui se passe aujourd’hui. Je cite un reportage de la BBC datant de mars 2022 (après les rassemblements pro-ukrainiens des citoyens contre l’entrée des troupes russes dans la ville de Kherson). Les manifestants qui ont échangé des propos avec les militaires russes ont rapporté de semblables répliques des Russes : « Qu’est-ce qui ne va pas chez vous ? Nous sommes ici pour toujours. Vous devez juste vous y habituer. Nous vous protégeons. Comment pouvez-vous ne pas vous rendre compte que vous étiez trompés, mais qu’en réalité, nous sommes les libérateurs ? »
Dans son essai, Kundera ne souligne pas que les chars, les soldats, l’invasion — tout ce qui a défiguré son pays à l’époque — étaient soviétiques (c’est apparemment cela qui a blessé Brodsky). Il ne perd pas son temps à faire la distinction entre « russe » et « soviétique », une distinction à laquelle on pourrait, si on le souhaitait (et non sans raison), consacrer de nombreuses lignes, voire des pages.
Pour Kundera, il s’agit d’étiquettes. Lui, il s’intéresse au contenu — apparemment commun à ces deux produits de l’histoire — et, à cet égard, il souligne un aspect essentiel : il écrit sur le sentiment, la sensibilité, « la superstructure de la brutalité » selon les mots de Jung (en d’autres termes, le complexe du « plus noble des sentiments nationaux ») qui remplace la raison et au nom de laquelle « on commet les pires atrocités ».
Par coïncidence, c’est dans les jours qui ont suivi l’invasion soviétique de Prague que Kundera a lu Dostoïevski et en a conclu qu’il était un artiste dont « les sentiments sont essentialistes, promus au rang de vérité ». Ce n’était pas la première fois que Kundera lisait Dostoïevski ; il avait relu L’Idiot à l’occasion d’un projet de mise en scène de ce roman pour le théâtre. Bien qu’il se trouvât alors dans une situation financière difficile, Kundera avait finalement renoncé à ce projet. L’univers de Dostoïevski, « fait de gestes démesurés, de profondeurs obscures et de sentimentalité agressive », lui répugnait.
« Ce qui m’irritait chez Dostoïevski, c’était l’atmosphère de ses romans : un univers où tout se transforme en sentiment, c’est-à-dire où le sentiment est promu au rang de valeur et de vérité ». Et là où il y a un sentiment de possession de la vérité, il y a aussi le sentiment que, même si c’est à regret, « nous sommes obligés d’utiliser des chars pour leur apprendre ce que signifie aimer ».
Dans son essai de réponse, Brodsky s’en tient précisément à cela — le trait d’égalité entre les chars et la culture. La rencontre de l’écrivain avec un soldat des forces d’occupation suscite de l’empathie, « mais seulement jusqu’à ce qu’il commence à généraliser au sujet de la culture que ce soldat représente ». La peur et le dégoût sont compréhensibles, mais « les soldats ne représentent jamais une culture, et encore moins, une littérature — ils portent des fusils, pas des livres ».

Trois ans après la publication de cet essai, les mêmes mots ont été prononcés (dans le feu d’une polémique qui n’a pas échappé à Brodsky) lors d’une célèbre conférence réunissant des écrivains soviétiques et des écrivains russes émigrés, qui s’est tenue à Lisbonne en 1988. Ils ont été prononcés par l’écrivaine Tatiana Tolstaïa, qui, à cette occasion, a délibérément qualifié Brodsky de « génie », révélant peut-être le fond de sa pensée :
« ...nous ne sommes pas ceux à qui les chars obéissent. Nous sommes des écrivains. Et nous, comme tous les gens normaux, nous avons au sujet des chars une opinion certaine [mot mis en évidence par moi, NDA]. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un parmi nous qui aurait toléré le principe de tuer ne serait-ce qu’une seule âme qui vive. »
Une personne n’était peut-être pas présente à la conférence de Lisbonne, mais elle grandissait déjà à ce moment même dans la maison de Tatiana Tolstaïa, à savoir son propre fils, le designer Artemy Lebedev, lequel n’a pas honte aujourd’hui d’exprimer sa sympathie pour Poutine.
Analysant les motivations de son adversaire, Brodsky voit en Kundera un homme qui « cherche fébrilement où jeter le blâme ». Le doigt de Kundera, écrit Brodsky, « pointait directement Dostoïevski ». Et c’est ici que Brodsky, qui partout, contrairement à Kundera, utilise l’adjectif « soviétique » plutôt que « russe » pour parler des chars, souligne que l’étiologie de Kundera est erronée, ou du moins pas aussi symétrique :
« Les atrocités qui ont été et sont commises dans ces pays ont été et sont commises non pas au nom de l’amour, mais au nom de ce qu’on nomme “nécessité historique”. Le concept de “nécessité historique” est le produit de la pensée rationnelle ; il est arrivé sur le sol russe par l’Occident ». Mentionnant que Das Kapital a été traduit en russe de l’allemand, le poète russe rappelle également que « le spectre du communisme » n’a jamais rencontré autant de résistance qu’en Russie, et que cette résistance a commencé avec Les Démons de Dostoïevski. Mais Brodsky, après avoir fait un glissement sémantique vers ce qu’il supputait être « l’influence corrosive de l’Occident », s’efforce de donner une définition plus nuancée. Il admet que « le système qui a privé M. Kundera de revenus est tout autant un produit du rationalisme occidental que du radicalisme émotionnel oriental », mais il termine ce passage par une affirmation : « Bref, en voyant un char russe dans la rue, il y a toutes les raisons de penser également à Diderot. »
Comme nous le savons, le rapprochement entre l’économie politique de Marx et l’impérialisme soviétique est encore moins justifié. Diderot était un philosophe qui manifesta son rationalisme en appelant personnellement l’impératrice Catherine à brider le caractère « oriental » de la Cour de Russie. Pour démontrer à quel point l’accusation de Brodsky diverge de la réalité, il n’est pas inutile de citer une étude spécialisée sur ce sujet — Diderot et la civilisation de la Russie de Sergueï Mezine (sur la couverture, le portait de Diderot figure en face d’une gueule d’ours) :
« Diderot est resté un fervent partisan de la paix et n’a vu aucun avantage à la politique de conquête de la Russie. Dans sa lettre, où il félicitait Catherine II pour la conclusion d’un traité de paix avec les Turcs3, Diderot n’est pas enclin à admirer les victoires militaires de la Russie : « Les triomphes répétés donnent sans doute de l’éclat aux règnes, mais les rendent-ils heureux ? » Il écrit sur la nécessité de chérir chaque goutte de sang russe, de ne pas la sacrifier au nom de la gloire et de la conquête. « Le progrès de la raison », disait-il, « met en avant d’autres valeurs plus humaines ».
La « précision » de Brodsky est remarquable. Sur un ton assuré, dénué de coquetterie intellectuelle, il écrit sur un sujet en s’éloignant de la réalité à 180 degrés, manifestement par goût pour l’analyse critique des Lumières professée par des représentants éminents de l’école de Francfort alors en vogue. Il trouvait cette analyse critique « à son goût » parce qu’elle légitimait parfaitement ses griefs contre Kundera et parce que Brodsky était tout incapable de s’attarder sur les détails. Il traitait les polémiques critiques comme s’il s’agissait de poèmes : « Celui qui écrit un poème l’écrit avant tout parce que l’écriture en vers est un extraordinaire accélérateur de la conscience, de la pensée, de la compréhension de l’univers »4.
Le mode de pensée de Kundera — auteur du roman La Lenteur5 (dans lequel la rapidité est synonyme de vulgarité) — est d’une nature quelque peu différente. Après avoir relu L’Idiot, il a eu la nostalgie de Diderot et a décidé d’écrire une pièce de théâtre à partir de son roman. Pourquoi l’écrivain tchèque revendiqua t-il dans cette période difficile pour lui et pour son pays cette proximité avec Diderot et son roman Jacques le Fataliste ? Kundera l’explique : « Mais en comparaison avec les autres activités de Diderot, Jacques le Fataliste n’était-il pas un simple divertissement ? » [mot mis en évidence par moi, NDA]. Il précise immédiatement de quel type de divertissement il s’agit : « Je l’affirme catégoriquement : aucun roman digne de ce nom ne prend le monde au sérieux. D’ailleurs, que signifie “prendre le monde au sérieux” ? Cela signifie certainement ceci : croire en ce que le monde veut nous faire croire. […] »
Essayons de comparer cette réflexion avec celle de Brodsky sur le même sujet: « Si la littérature a une fonction sociale, c’est peut-être de montrer à l’homme ses capacités ultimes, son maximum spirituel. »
Traduisons ces formules en langage plus concret. Face au « déclin de l’Occident », Kundera n’écrit pas quelque chose du style « descente aux enfers », mais se contente de parler de « l’insoutenable » et cependant de la « légèreté de l’être ». Brodsky est plus sérieux : lorsqu’il s’agit de parler du « maximum spirituel », il ne peut en aucun cas être question de divertissement et de « légèreté ». « Les Russes sont appelés à des affaires sérieuses », comme le dit le Marquis de Custine, auteur des Lettres de Russie.
On pourrait dire alors que Kundera se situe non seulement sur un tout autre rivage mais qu’il ne juge pas nécessaire de s’amarrer à quoi que ce soit. Analysant l’évolution de la sensibilité en Occident, Kundera pointe que « depuis la Renaissance, cette sensibilité occidentale a été équilibrée par un esprit complémentaire : celui de la raison et du doute, du jeu et de la relativité des affaires humaines. C’est alors que l’Occident s’est véritablement affirmé. »
Pour Kundera, la naissance de l’Occident est associée à cette qualité même, à la prise de conscience que tout « maximum spirituel », aussi important qu’il puisse paraître, doit respecter un certain nombre de conditions. En tout cas, il considère que la fonction de la littérature est remplie là où elle remet en cause ce à quoi on nous fait croire : la solidité du monde, son sérieux. En même temps, Kundera n’est pas un adepte de la déconstruction totale. Pour lui, « l’esprit du roman est l’esprit de la complexité », mais cette complexité est liée au doute (dans L’art du roman, Kundera souligne que Proust a remis en question le passé et Joyce le présent, et il voit là leur principal mérite en tant qu’écrivains).
Kundera développe sa pensée sur le roman du grand écrivain français des Lumières comme suit : « Diderot crée un espace inédit dans l’histoire du roman : une scène sans décor. D’où viennent les personnages ? Nous ne le savons pas. Quels sont leurs noms ? Cela ne nous regarde pas. Quel âge ont-ils ? Non, Diderot ne fait rien pour nous faire croire que ses personnages existent réellement à un moment donné. Dans tout le déroulement du roman, Jacques le Fataliste représente le rejet le plus radical de l’illusion réaliste et de l’esthétique du roman “psychologique”. »
Ainsi, Kundera demande si la mission de l’écrivain doit consister à extraire la vérité « des décombres », tandis que Brodsky l’attaque comme si de tels questionnements n’avaient pas été exprimés : « L’Occident n’a jusqu’à présent pas produit d’écrivain égal à Dostoïevski dans l’appréhension des profondeurs », écrit-il. Le poète russe aboutit également à une autre conclusion du même genre : « L’homme métaphysique des romans de Dostoïevski a plus de valeur qu’un fragile personnage rationnel de l’œuvre de M. Kundera, même si c’est un personnage moderne et ordinaire. »
Dans un certain sens, on peut être d’accord avec Brodsky sur ce point. Il est vrai que nous ne pouvons pas parler de la valeur de ce que Brodsky appelle « l’homme métaphysique », mais de celle de notre connaissance à ce sujet. Dostoïevski, même au stade de la rédaction des Carnets du sous-sol, proposait de tenir compte du fait que « la volonté de chaque individu (l’amour-propre) et son obstination forment une force destructrice qui jouit de sa cruauté envers les autres » (Czesław Miłosz). Cette connaissance des « sous-sols » de l’homme (en termes moderne, de son « discours caché ») est particulièrement importante, aujourd’hui plus que jamais.
Sans ce discours caché, il est tout simplement impossible de comprendre les frappes destructrices absurdes et à grande échelle que la Russie inflige à l’Ukraine selon une logique brutale, incompréhensible pour le sens commun. Pour cette raison, Dostoïevski, entre autres, ne devrait pas être ignoré mais étudié en détail comme une sorte d’anamnèse du patient.
Kundera ne s’est pas penché sur ces « abîmes » parce qu’il était manifestement plus rationnel, plus léger. Reprenons ses textes et essayons de découvrir comment cet « accusé » (et l’Occident avec lui, sur le même banc des accusés) expliquait sa position face à son supposé manque de compréhension des « profondeurs ». Abordant dans le même essai le roman Tristram Shandy de Sterne, qui a servi en quelque sorte de point de départ à l’œuvre de Diderot, Kundera écrit que cette œuvre « n’est pas sérieuse du tout ; qu’elle ne nous fait croire en rien : ni en la vérité de ses personnages, ni en la vérité de son auteur, ni en la vérité du roman en tant que genre littéraire. Tout est remis en question, tout est exposé au doute ; tout est divertissement (divertissement sans honte) »…
C’est dit de manière si claire et répétée qu’il n’y a pas de doute : l’« accusé » (Kundera) n’a jamais pris une pelle pour creuser et on lui reproche que le trou ne soit pas profond.
Brodsky, lui, préfère ne pas s’en apercevoir, estimant manifestement que le manque d’appétence de Kundera pour « creuser » traduit en réalité son incapacité à le faire. Kundera, selon Brodsky, et c’est à ce moment-là que son « verdict » se précise, présente des signes évidents d’hédonisme coupable en s’adressant à l’individu rationnel dépourvu de grâce en tant que tel. Après avoir souligné l’ensemble des relations de cause à effet qui ont troublé la conscience de l’écrivain, Brodsky passe aux détails. Tout d’abord, Kundera a été selon lui soumis à un régime esthétique strict qui se traduit par l’usage fréquent qu’il fait de métaphores sexuelles pour décrire la conduite humaine. Il convient ici de rappeler que pour Brodsky, l’érotisme comme l’amour ne sont pas des « thèmes pour la poésie ». C’est trop sérieux. Les origines de cette prise de position sont multiples et vont bien au-delà des racines culturelles russes. En guise de plaisanterie, il convient de noter que durant l’enfance et l’adolescence de Brodsky en URSS, une chanson très populaire du film Le Lent Voyageur du ciel (Nebesny Tikhokhod, 1945) disait :
D’abord, d’abord, des avions,
Et ensuite — les filles, et ensuite — les filles.
L’admiration incomparable du poète pour l’aviation nous permet de citer ces lignes avec un double propos. Rappelons que Brodsky lui-même ne voyait guère de différence entre les ragots et la métaphysique et qu’il estimait que le film « Tarzan » avait eu davantage d’influence sur la déstalinisation que tous les discours de Khrouchtchev réunis.
Les auteurs qui ont critiqué cet article de Brodsky, et parmi eux de nombreux auteurs russophones, notent qu’« au fond, Brodsky n’a rien à dire ni sur Dostoïevski ni sur Kundera. Cependant, il ne manque aucune occasion de détruire Kundera avec une démagogie insignifiante » (je cite A. Pekourovskaïa, autrice du livre « Unpredictable » Brodsky). Cette remarque n’est qu’en partie exacte.
Il est vrai que le style de cet essai et de bien d’autres essais de Brodsky ressemble à une sorte d’impasse stylistique (nous utilisons ici l’étiquette que Brodsky lui-même « attribuait » à tous ceux qui sympathisaient avec l’avant-garde). L’ami-adulateur du poète, Lev Lossev, a noté que « les pensées individuelles et les observations impressionnistes de Brodsky s’entrechoquent, forçant l’imagination du lecteur à travailler dans la même direction que celle de l’auteur ». En réalité, il n’en est rien : le texte de Brodsky ressemble plutôt à un coup de massue polémique qui rappelle la définition que Brodsky s’est donnée dans son essai Collector’s item, celle d’un bâtard. « Un bâtard, alors, mesdames et messieurs, c’est un bâtard qui parle. Ou bien un centaure. » Les coups qu’un tel centaure inflige à ses cibles n’atteignent celles-ci que dans l’imagination de Brodsky. En réalité, il s’agit toujours d’une « punition de la mer » : spectaculaire, mais inutile.
Et pourtant, l’essai de Brodsky exprime une pensée qui mérite d’être considérée à part entière : « On peut craindre que la conception que Dostoïevski a de la civilisation européenne soit quelque peu limitée ou déséquilibrée, puisqu’il ne s’en considère pas partie prenante et qu’il est identifié comme une menace pesant sur elle ». Dostoïevski comme menace pour la civilisation occidentale ?! Cela semble excessif. Entre-temps, Brodsky, qui a interprété la pensée de Kundera quitte à la déformer, exprime des idées qui, après le 24 février 2022, ne semblent plus aussi paradoxales. Kundera, qui connaissait bien les œuvres de Dostoïevski et qui les cite dans ses autres textes comme des exemples d’observation justes et caustiques, ne recourt pas dans son article à des analyses aussi englobantes que celles de Brodsky. D’autres écrivains, comme Lawrence, ont noté chez Dostoïevski un aspect qu’il convient de rappeler ici : la perspicacité remarquable de ce classique russe est mêlée à une perversité dégoûtante (je cite l’article de C. Milosz intitulé « Dostoïevski et l’imaginaire religieux occidental »). Cependant, distinguer ainsi dans les textes de Dostoïevski de manière claire la « perspicacité frappante » d’une part et la « perversité dégoûtante » d’autre part traduirait selon nous d’un manque de compréhension de ce qu’est la littérature.
Brodsky exprima ici son indignation. En forçant le trait de manière ironique et en se moquant de son adversaire, il a prétendu qu’il n’y avait ni « perversité dégoûtante », ni attitude réactionnaire dans l’œuvre de Dostoïevski. On pourrait l’assimiler à ceux qui aujourd’hui pratiquent la cancel culture en s’attachant à souligner les côtés négatifs de la vision du monde exprimée par ce classique russe. En restant fidèle aux pratiques de l’analyse critique, essayons de faire la part des choses. Quelle était la part de vérité et celle de la spéculation lorsque Brodsky affirme que Dostoïevski, du point de vue de Kundera, est une menace pour la civilisation occidentale ?
En février 2022, le contexte permet plus aisément que jamais de répondre à cette question. Aujourd’hui, la Russie est en guerre contre l’Ukraine et menace directement l’ensemble de l’Occident. On pourrait affirmer que la légitimité du pouvoir russe qui a déclenché cette guerre est discutable et donc que les actions des autorités — de Poutine en particulier — ne sont pas celles de toute la Russie. L’élite des communicants russes avaient là, face à la guerre d’agression lancée par la Russie, une parfaite occasion de montrer (ou de déclarer) que la Russie (sa culture, y compris Dostoïevski) est une chose, et que les personnes qui ont usurpé le pouvoir — en sont une autre. Mais malgré le nombre et le caractère évident des crimes commis par le régime de Poutine, cela ne s’est pas produit.
Citons ici un épisode mineur mais révélateur du contexte actuel. En 2016, Igor Volguine, président de la Fondation Dostoïevski, proposa à Poutine de présider un comité pour célébrer le 200e anniversaire de la naissance de l’écrivain et rappela aux participants de la table ronde qu’« aux yeux de l’Occident et de l’Orient, Dostoïevski est un symbole de la Russie ». Ainsi, malgré l’annexion de la Crimée et le début de la guerre hybride en Ukraine (ainsi que d’autres campagnes militaires du Kremlin), le Kulturträger russe et l’un des principaux experts de Dostoïevski ne fuit pas Poutine, mais l’invite à se rejoindre aux préparatifs de la célébration. Cette attitude interroge : de quelle manière cette trinité — la Russie, Dostoïevski et Poutine — s’organise t-elle ? Les limites entre ces composantes peuvent-elles être clairement définies ?
Brodsky conclut son essai en rappelant que « la civilisation occidentale et sa culture, y compris l’approche de M. Kundera, sont fondées avant tout sur le principe du sacrifice, sur l’idée d’un homme mort pour nos péchés ». Évidemment, formuler une telle chose en 1985 est anachronique. On aurait pu affirmer cela avec un tel pathos prédicateur il y a deux cents ans. De nos jours, la civilisation occidentale ne peut plus être définie comme une civilisation où les origines religieuses seraient déterminantes.
La civilisation européenne moderne repose avant tout sur l’attachement « aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit » (je cite le préambule du Traité sur l’Union européenne). Si elle peut renvoyer à une certaine tradition religieuse, aucune des valeurs énumérées ci-dessus n’est pour autant réductible à celle-ci. Si l’idée de sacrifice ou l’image de Jésus-Christ étaient fondamentales pour l’Europe moderne, personne n’aurait eu honte de le souligner dans les documents officiels. Brodsky refusait pour autant cette réalité. Son comportement rappelle cette citation de Dostoïevski : « Si quelqu’un m’avait prouvé que le Christ est en dehors de la vérité, et s’il était vrai que la vérité est en dehors du Christ, je préférerais rester avec le Christ plutôt qu’avec la vérité… » Il est bien connu que « l’idée russe » de Dostoïevski — et la vision russe des valeurs véritablement européennes — est basée sur des aspects religieux. Cela explique que Dostoïevski soit perçu comme un symbole de la Russie (un symbole de son isolement — près de la moitié du livre en trois volumes de T.G. Masaryk La Russie et l’Europe était consacrée à Dostoïevski et à des thèmes connexes).

Mais quel est le rapport entre « l’hégémonie du sentiment » dont parle Kundera et le fait que Dostoïevski, et Brodsky après lui, ont privilégié l’aspect religieux dans leur hiérarchie des valeurs (il est d’autant plus raisonnable de se poser cette question que l’invasion de la Tchécoslovaquie fut manifestement menée par des athées) ?
Dans la petite partie de son article où Kundera aborde ces questions, il formule ses arguments brièvement mais de manière convaincante et cohérente. Il explique que « l’élévation du sentiment au rang de valeur remonte assez loin, peut-être même au moment où le christianisme s’est détaché du judaïsme. Un vague sentiment d’amour (“Aimez Dieu !” — l’impératif chrétien) supplante la clarté de la Loi (l’impératif du judaïsme) pour devenir le critère plutôt flou de la moralité ». Il n’est pas exagéré de dire que Kundera parle ici en d’autres termes de ce que le préambule du traité de l’UE formule comme « l’État de droit ». L’attachement à un sentiment religieux fondé sur l’amour de Dieu — ou au communisme, dont le caractère quasi-religieux est tout à fait évident — sont pour Kundera des choses trop obscures pour être un critère de moralité.
Si nous essayons de tirer une brève conclusion sur la différence fondamentale entre les deux attitudes, elle est la suivante : Kundera souligne la relativité de tout. Quel que soit le sentiment, même si ce sentiment est sublime et lié à l’amour de Dieu, à la construction du communisme ou à la préservation de la sécurité du pays, il ne doit pas occulter la nécessité de suivre les exigences simples et claires de la loi, des règles, des normes. Dostoïevski, pour sa part, et Brodsky lui fait écho, voit le Christ, l’homme-Dieu qui s’est sacrifié pour nos péchés, au sommet de la hiérarchie. Kundera estime que la réalité elle-même, indépendamment de sa traduction concrète, peut être remise en question dans le roman, tandis que Brodsky voit dans l’art une sorte de guide métaphysique qui montrera aux gens le chemin vers ce qui existe de façon sûre et certaine. L’une de ces certitudes est d’ailleurs l’expérience personnelle de l’artiste. Dostoïevski, qui considérait « sa propre expérience comme irréfutable » (Joseph Frank, Dostoïevski, un écrivain dans son temps6), était très loin d’accorder une quelconque valeur à la relativité.
Y a-t-il quelque chose de plus à tirer de tous ces énoncés programmatiques qu’une simple analyse de l’ordre des mots, des chapitres ou des accents que l’on peut faire à la lecture d’un texte littéraire ?
Nous nous attacherons à répondre à cette question dans le prochain article pour lequel nous nous appuierons non seulement sur l’analyse faite par le chercheur américain Joseph Frank, mais aussi sur celle d’un autre Tchèque, Tomáš Masaryk (Président de la République tchécoslovaque entre 1918 et 1935), qui a aimé Dostoïevski toute sa vie, mais qui a fini par dénoncer le sens de la fameuse « pan-humanité » promue par ce dernier comme un masque de chauvinisme et d’impérialisme. Tomáš Masaryk, sociologue de formation, estimait qu’en faisant la promotion d’une sensibilité synthétique et universelle de la « toute-humanité » chrétienne, « Dostoïevski avait à l’esprit l’unification des peuples sous la direction de la Russie » — une union universelle « avec toutes les tribus de la grande race aryenne »7.
Note de la rédaction
La relecture des textes de Kundera et Brodsky appelle néanmoins deux remarques. D’une part, au début de son texte, Milan Kundera rapporte que, sollicité pour écrire une adaptation théâtrale de l’Idiot, il avait relu le roman de Dostoïevski et avait éprouvé qui lui était impossible de faire ce travail. Et il indique qu’il en a lui-même été surpris. Il rapproche ensuite cette impossibilité d’un souvenir personnel d’août 1968, lors de l’intervention des troupes du Pacte de Varsovie pour mettre fin au Printemps de Prague, lorsque trois soldats russes avaient voulu fouiller sa voiture… Kundera, dont tous les livres furent alors interdits dans son propre pays, évoque une impossibilité psychique et non pas une décision délibérée de refuser par principe la proposition qui lui avait été faite. Jamais dans son texte, il ne vise toute l’œuvre de Dostoïevski, et encore moins tous les écrivains russes, bien au contraire, précise-t-il. Il importe donc de rappeler que jamais Milan Kundera n’a été partisan d’un boycott ou de l’annulation d’une quelconque culture, russe ou autre8.
D’autre part, Joseph Brodsky, qui semble piqué au vif, réplique de manière virulente à Kundera non sans mauvaise foi ni manipulation de son texte. Cette virulence est à rapprocher du poème très choquant qu’il écrivit pour fustiger la déclaration d’indépendance de l’Ukraine et qu’il lut en public, en 1992 à Palo Alto.
Traduit par Natalka Boyko-Jacura
Anton Pugach est né à Kyïv en 1969. Il a étudié à la faculté de philosophie de l'Université d'État Chevtchenko de Kyïv et aux cours supérieurs pour scénaristes et réalisateurs de Moscou. Il a servi dans l'armée soviétique, a travaillé dans la production cinématographique et télévisuelle et s'est engagé dans la distribution. Il est cofondateur et associé directeur jusqu'en 2018 de la plus grande chaîne de cinémas d'Ukraine, Multiplex. Il est également éditeur et publiciste.
Notes
- Milan Kundera, Jacques et son maître. Hommage à Denis Diderot, pièce en trois actes. Paris, Gallimard, 2014.
- Ibid.
- Traité de Koutchouk-Kaïnardji.
- Extrait du discours du Nobel de Brodsky : «The one who writes a poem writes it above all because verse writing is an extraordinary accelerator of conscience, of thinking, of comprehending the universe».
- Le septième roman de Kundera, écrit en 1993, publié en 1995, est son premier écrit en français.
- Paru en traduction française en 2019, Éditions des Syrtes.
- Extrait du discours de Dostoïevski consacré à Pouchkine.
- Merci à Hélène Bourgois qui nous a permis de préciser ce point important.