À ceux qui prétendent que le temps des Borgia et de Machiavel est de retour, il faut répondre que le véritable réalisme de l’auteur du Prince consistait non pas à décourager l’opinion publique de résister à l’oppression, mais à donner au peuple le moyen de comprendre comment et pourquoi mener le combat pour la liberté.
Où est passée l’Ukraine ? On pouvait se le demander pendant que les cours des bourses mondiales semblaient jouer aux montagnes russes, après les annonces et les revirements de Donald Trump sur les hausses brutales des taxes américaines à l’importation. Quel contraste avec, quelques semaines plus tôt, l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur le sort de l’Ukraine qui avait vu les États-Unis voter avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord ; avec ensuite la scène hallucinante de l’entretien dans le bureau ovale de la Maison-Blanche de Volodymyr Zelensky avec Donald Trump et son vice-président James David Vance ; et avec l’impressionnante série de réunions qui avait suivi entre partenaires occidentaux (à l’exception des États-Unis) l! Il s’agissait alors pour les Occidentaux, et en particulier pour les Européens, de marquer un soutien à Kyïv et de pourvoir, autant que possible, à la fourniture d’armes et d’équipements sans lesquels les Ukrainiens seraient en grande difficulté. Force est de constater que, pour le plus grand bonheur de Vladimir Poutine, l’agitation forcenée du président américain tend à faire du sort de l’Ukraine un sujet secondaire. Peu importe, semble-t-il, que l’offensive russe soit considérablement ralentie dans tous les oblasts annexés par Moscou. Peu importe même que, conséquence de la pagaille économique mondiale que Trump organise, le prix du pétrole s’effondre et mette – si elle se poursuit – la Russie en grande difficulté, comme l’explique elle-même Elvira Nabioullina, la présidente de la Banque centrale russe. Le monde regarde ailleurs. En quelque sorte, l’Ukraine, tout en étant confrontée à la guerre d’agression russe, devient une victime collatérale de la politique MAGA.
Il y aurait beaucoup de chose à dire des interactions entre les différentes crises et conflits planétaires et de leur caractère systémique, mais il faut, concernant l’Ukraine, s’arrêter sur le point suivant : la situation créée par les conséquences de la réélection de Donald Trump, dont on découvre chaque jour l’ampleur et les nouvelles facettes, voit revenir en force le discours d’un prétendu « réalisme », qu’on avait vu à l’œuvre avant et après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, et dont le dernier avatar est la sortie tonitruante du nouveau livre de Giuliano da Empoli, L’heure des prédateurs. Celui-ci nous explique que le monde revient à sa tendance naturelle qui est d’être le terrain d’affrontement des puissants et que la prime va au cynisme et à la cruauté, comme l’aurait démontré Machiavel, grand admirateur de César Borgia. Pour le dire succinctement, les Borgia sont de retour, ils s’appellent Trump, Poutine, Ben Salman (le prince saoudien), Musk… c’est celui des présidents des empires qui se reconstruisent violemment et des patrons de la Tech qui rêvent d’un gouvernement par les algorithmes.
D’un mage à l’autre
Le livre de Giuliano da Empoli a fait l’objet dès le jour de sa sortie, d’une page entière d’entretien avec son auteur dans Le Figaro, sous ce titre éloquent : « Incapable de réagir, la vieille élite a mérité d’être balayée », et de deux pages d’interview dans L’Express, où l’auteur affirme que « les prédateurs représentent au fond le retour à la normalité du politique, régi par la force ». Notons au passage que celui qui fut conseiller de Matteo Renzi semble confondre la politique et le politique, c’est-à-dire, d’un côté, l’art de faire de la politique et, de l’autre, le champ dans lequel elle s’exerce et sa structuration. Ignorer cette nuance fondamentale peut conduire à de graves méprises dans la compréhension des situations et dans le choix des conséquences qu’il faut en tirer pour agir. Quelques jours plus tôt, paraissait un grand portrait de l’essayiste italo-suisse dans Libération, intitulé « Le mage de raison », clin d’œil, bien sûr à son livre qui rata d’une voix le prix Goncourt, portrait romancé et enjolivé de l’un des conseillers – mais non des moindres – de Vladimir Poutine. Livre dont Cécile Vaissié a critiqué solidement les « ambiguïtés gênantes » dans Desk Russie le 1er décembre 2022. Le Mage du Kremlin, sorti en avril 2022, a largement contribué à construire la légende de Vladislav Sourkov, qui s’était bien entendu prêté à la rencontre avec Giuliano da Empoli, sans doute parce qu’il pensait alors que ce projet de livre contribuerait à persuader les Occidentaux que soutenir l’Ukraine était peine perdue. Il ne s’agissait pas d’embellir le tableau du pouvoir russe actuel, le Kremlin n’en a que faire, mais, bien au contraire, de chercher à produire un effet de sidération pour saper les espoirs que pourrait susciter en Occident la résistance de l’Ukraine à l’agression russe. L’objectif russe a été globalement atteint, puisque le livre est devenu un best-seller mondial !
Quinze jours avant la sortie du dernier opus de Giuliano da Empoli, Vladislav Sourkov, qui ne s’était plus manifesté depuis longtemps, a opportunément accordé à L’Express un entretien publié sous le titre de Une suivant : « Le vrai mage du Kremlin parle. Entretien avec Vladislav Sourkov, l’homme qui a fabriqué Poutine ». En réalité, si les mots ont un sens, Sourkov n’a jamais « fabriqué Poutine », mais est lui-même une créature des « organes ». Selon l’ancien ministre russe de la Défense, Sergueï Ivanov, il a servi à la Direction générale des renseignements de l’État-Major des forces armées russes, plus connue par l’acronyme GRU, entre 1983 et 1985, période emblématique d’une réorientation des services de sécurité russes sous l’impulsion d’Andropov. Le chef du KGB, devenu en 1982 Premier secrétaire du PCUS après la mort de Brejnev, pensait que le pouvoir des siloviki devait se donner les moyens de survivre à l’effondrement du communisme. Ajoutons que le père de Sourkov a déclaré être entré au GRU après son service militaire (il aurait opéré au Vietnam), tandis que son grand-père aurait été un fidèle tchékiste. Bon sang ne saurait mentir…
Pour cet entretien « exceptionnel », Sourkov s’est fait longuement prier. Il aurait accepté de s’exprimer en apprenant que l’hebdomadaire avait accueilli les plumes de Malraux et de Sartre. L’Express, qui fait mine d’y croire, a accepté que l’entretien ne soit pas en face à face, mais réalisé par écrit, en deux temps, par l’envoi de deux séries de questions. Des conditions idéales pour que revienne de Moscou un texte parfaitement ciblé, calibré, non pas pour polir la langue de bois, mais pour mener une opération d’influence, un acte assumé de guerre psychologique. De fait, dans le texte signé par Sourkov, il ne s’agit toujours pas de séduire, de donner une image aimable de la Russie, on sait trop bien au Kremlin que ce n’est plus l’heure de faire risette, mais d’effrayer, d’afficher une détermination capable de décourager l’opinion publique française alors qu’Emmanuel Macron, revenu de ses errements du début de l’année 2022, se veut le fer de lance du soutien à Kyïv en Europe, et qu’il cherche comment les Alliés pourraient offrir à l’Ukraine, si un accord de paix était trouvé, les garanties de sécurité que Washington se refuse à fournir.

Une séquence impressionnante
La publication de l’entretien de Sourkov est venue à point nommé, au moment où les Ukrainiens se retiraient d’une grande partie du territoire qu’ils avaient occupé depuis leur percée du 6 août 2024, dans l’oblast de Koursk, en territoire russe. Les circonstances et les causes de ce retrait rapide, interprété à chaud comme un effondrement et une défaite ukrainiens par nombre de commentateurs, restent obscures, même si la poussée russe est indéniable. Cet épisode de la guerre a donné lieu à une formidable opération de désinformation dont Donald Trump a été personnellement l’un des vecteurs, annonçant à tort l’encerclement de milliers de soldats ukrainiens, alors que des informations fiables démontrant le contraire étaient publiques. Ce qui semble sûr, c’est que, pour des raisons qui restent à éclaircir, les Ukrainiens ont été contraints à un repli tactique dans un moment crucial, qui était celui du début des manœuvres diplomatiques russo-américaines pour « régler » le conflit. Les guillemets, évidemment, s’imposent.
Rappelons que peu après l’altercation du Bureau ovale, le 28 février, le Président des États-Unis avait décidé de suspendre les livraisons d’armes et la fourniture de renseignements militaires à Kyïv, et que les négociations qui venaient de commencer entre Russes et Américains à Dubaï mettaient en scène une forme de lune de miel entre Moscou et Washington. Bref, tout visait à installer l’idée que sous la pression de Trump, les Ukrainiens n’auraient d’autre choix que de plier devant les exigences russes et que les Européens, laissés sur la touche, devraient se résigner à faire moins que de la figuration. Pourtant, à ce jour, les Ukrainiens tiennent encore une petite partie de territoire dans l’oblast de Koursk, ils ont commencé à porter le combat à la frontière russe en direction de Belgorod, ils ont presque stoppé les offensives russes autour de Pokrovsk et de Toretsk, et la réalité du terrain indique qu’après les énormes pertes enregistrées par les Russes depuis l’automne dernier en vue d’arriver à la table des négociations en quasi-vainqueurs, l’armée de Vladimir Poutine est dans une situation de grande fragilité, alors que la guerre a mis l’économie civile de la Russie en sérieux danger. On se trouve donc devant le paradoxe suivant : c’est au moment où le pays de Poutine est affaibli que Trump lui tend la main ! Le maître du Kremlin ne se contente pas de la saisir, il tente de faire croire que la partie est jouée et que l’heure est venue d’un nouveau partage du monde…
Ainsi donc, la séquence à laquelle on a assisté depuis l’altercation dans le Bureau ovale, avec le retrait ukrainien contraint d’une large partie du territoire conquis en août dernier dans l’oblast de Koursk, les négociations russo-américaines en Arabie saoudite, l’interview de Sourkov et enfin la publication en fanfare de L’heure des prédateurs de Giuliano da Empoli, contribue à installer dans l’opinion publique la conviction que l’Europe et ses alliés, au sein d’une OTAN dont les États-Unis veulent rester les maîtres tout en signifiant qu’ils ne se sentent plus tenus par les termes de l’Alliance, n’ont plus qu’à regarder passer les trains des grands carnassiers de la planète, en humbles herbivores incapables de se défendre qu’ils seraient.
Les faits et les interprétations
Il serait bien évidemment excessif de dire que tout cela est organisé ou concerté, mais il est évident que l’appareil de propagande russe ne se prive pas de fournir de manière abondante des lectures et interprétations des événements et de leur succession qui labourent non seulement les opinions publiques, mais aussi les représentations des acteurs politiques des différents pays concernés. Cela ne se borne pas, loin de là, aux déclarations publiques russes, cela passe par des commentateurs occidentaux impressionnés, et pour certains influencés, qui peinent à distinguer les faits des interprétations qui leur sont suggérées via les canaux les plus divers. Rappelons que tous les acteurs, y compris occidentaux, fournissent des éléments de langage qui les servent, mais qui ne constituent pas nécessairement « la vérité » des faits, et que des fuites organisées visent souvent à orienter la lecture des événements pour servir des objectifs déterminés. On l’a vu abondamment, et depuis des mois, par exemple, autour de la question de la légitimité prétendument douteuse du président Volodymyr Zelensky. Les effets de loupe sont multiples et répétés dans un système médiatique dominé par les questions d’audience dont les analyses sont guidées par les algorithmes, et par l’impact des réseaux sociaux eux-mêmes largement sous influence. Le scepticisme qui devrait s’imposer à l’observateur fait d’autant plus défaut que la profondeur historique manque fréquemment pour corriger les biais des interprétations « en direct ».
C’est sur ce « fond de sauce » que tend à s’imposer le discours sur le « réalisme » qui vise à nous persuader, comme le répète avec gourmandise et constance l’ancien ambassadeur de France aux États-Unis Gérard Araud, que l’on est revenu à ce que la politique internationale a toujours été, à l’exception d’une brève parenthèse « heureuse » dans la seconde moitié du xxe siècle et jusqu’à ce que Poutine passe à l’action : le combat sans morale de chaque nation ou empire pour ses intérêts, par la guerre ou par la diplomatie et la politique qui ne seraient que la poursuite de la guerre par d’autres moyens. C’est la thèse de Giuliano da Empoli qui se poursuit avec L’heure des prédateurs, sur la lignée d’une réflexion entamée depuis son livre Les ingénieurs du chaos paru en 2019. Mais l’écrivain et conseiller politique italo-suisse né en France ajoute aux « princes de ce monde » les grandes firmes de la Tech et leurs patrons, et il est vrai que ces derniers disposent de moyens qui excèdent ceux de nombreux États dans le monde. Da Empoli évoque la figure de César Borgia, dont, écrit-il, « Machiavel fera le modèle de son Prince : non pas le souverain idéal, mais la bête de pouvoir réelle, moitié renard et moitié lion, sachant utiliser l’astuce pour flatter les hommes et la force pour les subjuguer ». Notre temps serait donc celui des nouveaux « borgiens ». L’auteur choisit cette fois un procédé impressionniste. Non pas un discours méthodique, mais l’exposé de saynètes saisissantes, glanées au fil de ses fréquentations des puissants et de ses voyages. Effets-chocs garantis. Faut-il le créditer, comme le fait son éditeur en quatrième de couverture, de « la lucidité d’un Machiavel et [de] la hauteur de vue d’un moraliste » ?
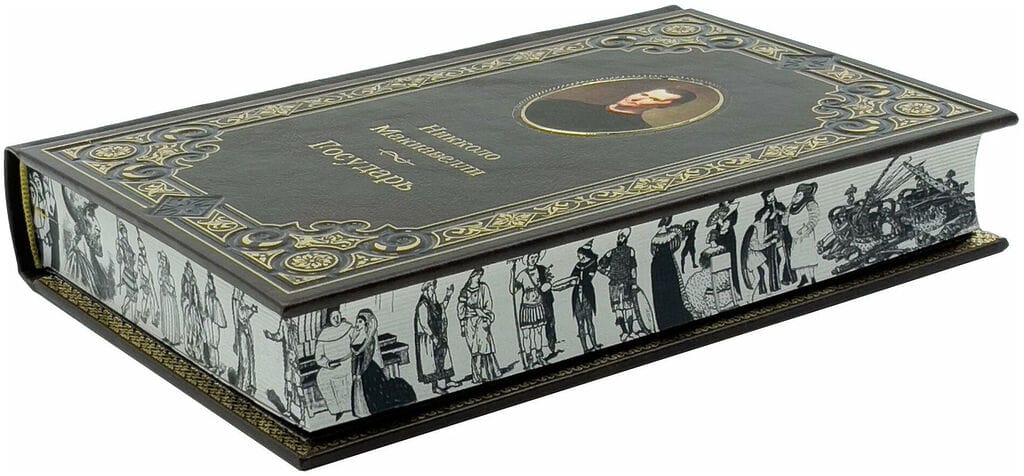
Machiavel, un vrai républicain
De Machiavel, il semble avoir retenu, comme beaucoup, l’image d’un conseiller politique cynique et désabusé. L’inventeur du « machiavélisme ». Mais cette image est une légende que le philosophe Claude Lefort, pour ne citer que lui, a depuis longtemps démontée. L’auteur du Prince, semble oublier Giuliano da Empoli, était en réalité un républicain convaincu. Il n’a pas rédigé un manuel de la tyrannie, mais cherché à montrer que la République ne trouvait sa vérité que dans l’affrontement de deux désirs antagonistes, celui des grands qui veulent dominer et celui du peuple, derrière lequel il se rangeait, qui refuse d’être oppressé. Son « réalisme », loin d’être fataliste, visait à donner les éléments nécessaires pour engager en toute connaissance de cause le conflit qui était selon lui le ressort profond d’un bon fonctionnement de la République. Ce que défendent les soi-disant « réalistes », c’est une lecture borgne et tronquée de Machiavel.
L’auteur du Prince, mais aussi des importants Discours sur la première décade de Tite-Live croyait non pas aux idéologies, non pas aux leçons de morales, non pas aux valeurs chrétiennes – qu’il accusait d’être démobilisatrices –, non pas aux beaux discours et aux exemples fascinants, mais à la « veritá effettuale », à la vérité effective de la chose politique, aux effets de la nécessité. Pour lui, l’injustice, pente naturelle des grands, ne pouvait être tempérée que par la résistance du peuple, et s’il décrit l’art de la politique avec une précision clinique, c’est pour permettre que le conflit des désirs opère ses effets bénéfiques d’ajustement. Dans son esprit, il ne faut pas se résigner, mais combattre.
Il n’y a donc pas d’avènement d’une prétendue « heure des prédateurs » qui ne nous laisseraient que le choix de nous soumettre, puisque les élites – européennes et américaines – n’ont pas su agir à temps. Ce dont nous avons besoin, c’est plutôt d’une analyse lucide et courageuse pour mener le combat et donner au « peuple » une vraie culture de la liberté et de la responsabilité. Celle-ci s’est dissoute dans le fleuve de la société de consommation, et le phénomène s’est accéléré depuis la chute du mur de Berlin. En ce sens, Zelensky est plus authentiquement disciple de Machiavel que Giuliano da Empoli, qui soutient que « dans ce monde nouveau les borgiens ont un avantage décisif, car ils ont l’habitude d’évoluer dans un monde sans limites ». L’ancien conseiller de Matteo Renzi oublie que selon Machiavel, c’est précisément l’absence de limite, l’absence de résistance qui conduit les dominants à la catastrophe, à l’échec ou à l’enlisement dans les marais de leurs succès. Ce que l’on peut déjà observer avec Donald Trump qui pourrait bien se révéler comme le pire ennemi des États-Unis : le 47e président américain n’est revenu au pouvoir que depuis trois mois et déjà il a fait la démonstration que ses obsessions produisent une politique qui met son pays en grand danger, que ce soit en matière de sécurité ou du point de vue économique.
La démobilisation fait son œuvre
Certes, l’essayiste italo-suisse a raison : les élites européennes ont tardé à réagir alors que, depuis le début des années 2000, les avertissements ne manquaient pas quant à la nature du régime de Vladimir Poutine. Nombre de ceux qui en font partie (mais pas tous) ont été naïfs, veules, « idiots utiles », voire corrompus pour certains, plus attachés à leur confort, à leur carrière et à leur image que lucides, il est vrai. Mais faut-il en conclure que l’heure de la République au sens où l’entendait Machiavel est passée ? Faut-il en conclure que celle de la démocratie, pour laquelle l’écrivain chinois Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, est mort en prison en 2017, n’est plus d’actualité ? Faut-il considérer que l’équilibre des pouvoirs pensé par Montesquieu n’est plus qu’un outil dépassé à remiser au rang des vieilleries qu’on oublie ? Le livre de Giuliano da Empoli se termine sur l’image du vaillant maire de Lieusaint qui se bat courageusement contre l’envahissement de son bourg par les flots de voitures téléguidées par Waze, mais sans espoir de faire mieux que vider la mer avec une petite cuillère… Ce maire n’appartient pas au monde des puissants dans lequel l’auteur évolue à son aise, comme une sorte de « dissident agréé », d’un non-conformisme délibérément autolimité. L’élégance et la prudence de celui qui s’installe dans la posture du fou des nouveaux princes borgiens accordent à l’édile de Lieusaint une forme d’admiration désespérée : « la lutte continue », écrit-il pour conclure à la fois le bref portrait du maire et le livre. Mais, en définitive, cette manière de dénoncer les prédateurs en concluant sur l’impuissance de ceux qui voudraient s’y opposer conforte l’idée que la bataille est perdue.
N’en doutons pas, cette démonstration démobilisatrice fait son œuvre. Si les réunions organisées par Emmanuel Macron et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, ont abouti à des déclarations de soutien à l’Ukraine, avec des promesses de livraisons d’armes, elles sont loin de déboucher sur un engagement décisif : Français et Anglais sont bien isolés lorsqu’ils évoquent l’idée d’envoyer des troupes au sol en Ukraine. Et encore n’y viendraient-elles pas prochainement pour renforcer Kyïv dans son combat contre l’agresseur, mais seulement pour garantir la mise en œuvre d’un accord de paix dont la signature reste aujourd’hui très hypothétique… On a surtout entendu répéter un nouvel élément de discours selon lequel l’armée ukrainienne était la première et la meilleure garantie de sécurité pour son pays. Autrement dit, l’aversion pour le risque et la réticence à agir continuent d’être les principaux ingrédients de la position occidentale sur l’Ukraine.
Servitude ou liberté ?
Là encore, il faut relire Machiavel. L’auteur du Prince, rappelle Lefort, misait sur la jeunesse, et c’est pour elle qu’il écrivait afin de lui donner les moyens de passer à l’action pour unifier l’Italie, car il avait vu que la « sagesse » des plus anciens les enfermait dans un conservatisme impuissant et morbide. Pour lui, la politique ne se concevait pas sans la prise de risque… Dans nos sociétés occidentales vieillissantes, la peur de mourir prend le pas sur le goût de la liberté. L’atermoiement l’emporte sur l’engagement. Pourtant nul n’échappera à la mort tandis qu’il appartient à chacun de participer à ouvrir dans l’histoire des temps et des espaces de liberté, non seulement pour lui-même, mais pour les générations à venir. Ce qu’Éluard avait bien compris lorsqu’il écrivit, en 1942, dans la France occupée par l’envahisseur allemand, son célèbre poème qui s’achève par « Je suis né pour te connaître/Pour te nommer/Liberté. »
Comprenons bien l’enjeu : ce qui se joue en Ukraine ne se limite pas à la question russo-ukrainienne. Il s’agit de savoir s’il existe encore, dans le monde occidental, dans ce monde né au début du premier millénaire, de la rencontre d’Athènes, Jérusalem et Rome, ce monde qui a inventé la République et la démocratie, le courage de vivre dans l’incertitude et le risque de la liberté qui caractérisent précisément l’une et l’autre. La question n’est pas de se demander si les chars de Poutine arriveront ou non un jour prochain à Berlin ou à Paris, mais si nous sommes déterminés à combattre ceux qui veulent aujourd’hui installer d’une manière ou d’une autre des régimes, des systèmes, des réseaux et des modes de domination sur toute la planète, que ce soit par la force, la démagogie ou la technologie – les trois se conjuguant souvent. Trouverons-nous en nous-mêmes l’énergie et le cran de nous insurger ou donnerons-nous aux générations futures le spectacle d’une nouvelle servitude volontaire, version contemporaine de celle que dénonçait en 1548 Étienne de la Boétie ? Car, comme l’écrit Lefort, commentant Machiavel, « c’est seulement là où le conflit trouve à se manifester, c’est-à-dire là où le peuple se montre capable de résister à l’oppression des grands, que se forgent de bonnes lois, que la République mérite vraiment son nom ». Nous n’en sommes donc pas au retour à une prétendue logique normale et cruelle « du politique » qui ferait de nous des spectateurs désarmés, sidérés par la marche du monde et le cynisme des puissants, mais au moment où l’histoire nous convoque à nous engager pour refuser toutes les logiques d’oppressions, qu’elles soient politiques ou technologiques. Les Ukrainiens ont fait leur choix. Et nous ?
Jean-François Bouthors est journaliste et essayiste, collaborateur de la revue Esprit et éditorialiste à Ouest-France. Il est auteur de plusieurs livres dont Poutine, la logique de la force (Éditions de l’Aube, 2022) et Démocratie : zone à défendre ! (Éditions de l’Aube, 2023). Il a été, avec Galia Ackerman, l’éditeur des livres d’Anna Politkovskaïa aux Éditions Buchet/Chastel.


